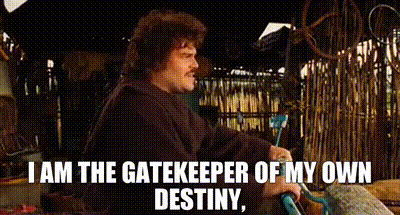Mon meilleur ennemi, c'est le temps
Un royaume de courses contre la montre, de deadlines et de craintes de la péremption
En lisant le titre de cette newsletter, vous aurez peut-être en tête le dernier morceau de Pomme et Stromae, sorti à l’occasion de la saison 2 d’Arcane (série que je ne cesserai jamais de vous conseiller, pour la masterclasse d’écriture).
Je t’aime ; je t’attends.
Cette relation d’amour-haine avec le temps, je la vis quotidiennement dans de multiples domaines. Et l’écriture n’est pas épargnée. Et d’ailleurs, si vous n’avez pas eu de newsletter ces dernières semaines, l’explication était toute simple : pas le temps.
Mais où est ce temps magique ? Certain.e.s en ont trop, d’autres, plus généralement, en manque. Ne le voient pas passer, le subissent. Il nous échappe toujours, insaisissable, inarrêtable. Alors comment danser avec le temps sur le même rythme ? Comment l’apprivoiser quand on se lance dans une passion/un travail aussi chronophage que l’écriture et l’édition ? J’avais grandement envie d’en parler aujourd’hui…
Avant cela, un petit rappel de votre hôte ! Avec le temps, vous m’avez peut-être oubliée, qui sait… ! Je suis Ielenna, autrice hybride spécialisée dans l’imaginaire pour échapper à la réalité. Ou du moins pour la raconter autrement. Dans cette newsletter, je décortique un sujet lié à l’écriture, au monde du livre et de l’édition. Car après 18 ans d’écriture, je commence à en avoir, des réflexions accumulées ! Des expériences que j’adore partager avec vous.
Vous êtes désormais 775 à suivre mes pérégrinations au sein de ce ✨blabla chatoyant✨ et je suis touchée de vous voir toujours de plus en plus nombreux.ses ! Un immense merci ! Et d’entretenir avec vous toujours plus de discussions différentes, car notre intérêt ici, c’est de pouvoir échanger nos points de vue. Je ne me targue pas d’avoir la science infuse et le mot juste. Toujours prête à me remettre en question, j’aime apprendre. Je considère que j’aurai TOUJOURS à apprendre dans le domaine. Le jour où je me dirai que je sais tout mieux que tout le monde n’est pas arrivé (et n’arrivera heureusement jamais !) Généralement, ce sentiment et cette façon de considérer ma vie d’autrice me font voir mes paroles avec du recul 5 ans plus tard et me dire “Sacrebleu, qu’est-ce que j’étais stupide à l’époque !”. C’est bien, ça montre qu’il y a toujours une marge de progrès, rien n’est perdu !
Hormis mon humour. Lui, il est cassé, personne n’y pourra jamais rien.
As always, cette lettre est trop longue pour être ouverte en entier par mail : ouvrez-la directement sur l’application Substack pour la savourer !
✨ Ah, jeunes années
Nous sommes aujourd’hui le 23 décembre (je ne finirai cette newsletter que quelques jours plus tard, avec l’interlude “fêtes”) et je ne trouve que maintenant le temps de me poser. Soit un mois et 21 jour depuis la dernière lettre. Quel échec. Cette belle newsletter que j’ai réussi à maintenir sur un rythme d’une lettre toutes les deux semaines. A la même fréquence que LMA par le passé, me suis-je fait la réflexion. LMA, c’est la fanfiction Harry Potter que j’ai écrit entre 2012 et 2020, dont j’ai pu longuement parlé dans ma lettre sur le sujet de cette œuvre aujourd’hui controversée du fait des prises de position ouvertement transphobes de son autrice. Un chapitre toutes les deux semaines, me direz-vous, ce n’est pas la mer à boire. Mes “chapitres” n’étaient pas comme tous les chapitres. Actuellement, mes chapitres oscillent entre 1500 et 3000 mots maximum (car la mode et le rythme de lecture valorisent les chapitres dits “courts” pour maintenir un rythme), une moyenne honorable. Les chapitres de LMA, eux, affichaient fièrement entre 10000 et 15000 mots. Soit 5 fois plus longs.

C’est ce genre de réalité, de mesure quantifiable, qui me fait prendre conscience d’une chose. En 2013 : j’avais LE TEMPS et l’énergie. Innocence étudiante, qui navigue entre ses cours, fournissant le minimum syndical pour s’assurer un diplôme. Pas d’administratif à gérer, allergique à toute vie sociale, célibataire, épanouie avec ses ami.e.s et ses communautés en ligne, par l’intermédiaire des forums et des blogs. Disons que j’ai fait des choix. Qui me correspondaient tout à fait à l’époque.
Aujourd’hui, l’inverse s’opère. J’ai beaucoup plus tendance à valoriser les temps avec mes proches. Oui. Moi, grosse asociale, j’aime passer du temps avec mes proches (même si je ne participe pas beaucoup. L’acte de présence me fait plaisir, c’est déjà ça !) Avec mon mari, quand je rentre du travail. Avec mes ami.e.s et collègues certains soirs. Avec mon père ou avec mes lecteurices en salon les week-ends. Avec mes proches pendant les vacances (sauf pour les promenades. Je déteste les promenades si ce ne sont celles obligatoires pour le toutou. Note du 24/12 : on m’a obligée à faire une promenade, je grogne un peu. Oui, j’ai 32 ans. Chut). Dans la limite de mon raisonnable ! - je reste un spécimen plutôt réservé. Mais j’ai pris conscience de la préciosité de ces moments irremplaçables, alors qu’écrire, je pourrai le faire autrement, ultérieurement. Aussi, ce temps libre se réduit comme peau de chagrin car j’ai fait des choix. Oui, je suis frustrée, car je n’ai plus autant de temps pour écrire (ou du moins, je le travaille autrement, vous allez comprendre). Pour lire, encore moins !
✨ Trouver l’inspiration, c’est du travail aussi
Eh oui ! Depuis que j’ai commencé à prendre la plume, en 2006, je lis en boucle “un.e bon.ne auteurice est avant tout un.e bon.ne lecteurice”. Comment vous signifier mon syndrome de l’impostrice, moi qui ne lis que 5 livres par an ? Moi qui, parfois, considère cela comme une corvée (oui, c’est difficile pour moi de me motiver à lire). Car le peu de mon temps libre, je dois faire un choix : lire ou écrire.
Avec les deadlines, le choix est vite fait. Des livres, j’en ai plein, j’en achète toujours trop. J’essaie de me convaincre autrement : je pratique la veille du milieu plutôt qu’une consommation active. Emmenez-moi en librairie, je pourrai vous donner le résumé d’une bonne moitié du rayonnage, vous énumérer les tropes, vous faire part des avis que j’ai fouinés sur les RS. J’achèterai toujours les livres des copaines auteurices dont je soutiens les valeurs, même si je les lirai quelques années plus tard. C’est ma manière à moi de “lire”. Car des livres commencés, je les accumule. Mon mari se moque d’ailleurs souvent de ma “PALE” : pile à lire entamée, avec ses marques-pages tous plantés vers la page 50 et qui prennent la poussière près du lit. Je suis une boulimique de lecture : un livre commencé doit être terminé le jour-même, sinon, je ne le finirai jamais. Quitte à le finir à 4h du matin. Hors, je n’ai pas le luxe d’une journée de libre en entier. Vous vous rendez compte ? Lire une journée entière… alors que je pourrai écrire pendant toute une journée à la place ?!
Quelquefois, je culpabilisais aussi de geeker. D’aller au cinéma. De consommer des médias. Alors que je pourrais être “productive”. Avec le temps, je me suis rendue compte que ce temps de consommation était (parfois / souvent) une part de mon temps de travail d’écriture. D’analyser les mécanismes d’écriture, de comprendre la construction des personnages, identifier les effets utilisés pour renforcer un sentiment. Que ce temps, j’en avais besoin. Imaginons 4h de libre, séparées en 2 journées. Si je regarde une série 2h le premier jour, je peux écrire 3000 mots le lendemain, très inspirée par les méthodes d’écriture ou les ambiances de la série de la veille. Tandis que si j’avais écrit sans rien, peut-être que j’aurai vivoté, écrivoté 1000 mots le premier jour, 200 le deuxième, déprimée par ma nullité, partant dormir en traînant des chaussons et se qualifiant d’écrivaine de bas-étage.
Tout est finalement question d’efficacité, de répartition des efforts. Et de sentiment de bon travail accompli qui m’amènera à retourner sur mon manuscrit. C’est pour cela, je crois, que c’est une mauvaise idée, pour ma part, d’écrire à temps plein. J’ai BESOIN de faire d’autres choses. De m’inspirer. Et que le temps d’écriture soit une récompense, la quintessence d’une perception du monde distillée avec mes mots. Rester chez moi, devant mon ordinateur, sans croiser personne, sans vibrer avec les lumières changeantes d’un extérieur, sans décrypter le langage non verbal d’un inconnu en face, sans ressentir le souffle d’une précipitation ou même les frissons d’une colère qu’on ne peut pas réfréner ; cela va-t-il me permettre de “mieux” écrire ? Pourrais-je retranscrire la réalité, sans jamais m’y confronter ? La vie est un temps d’écriture en soi. Et mon heure d’écriture quotidienne (quand j’y parviens !) est finalement un temps de décompression, de conscientisation de toutes les afférences de ce monde qui me fascine et me terrifie en même temps.
✨ Mais cloisonner quand même
Je l’avais expliqué dans une précédente newsletter, mais je DETESTE être interrompue pendant mon temps d’écriture. C’est un hyperfocus, c’est un état d’esprit particulier, celui où les mots s’alignent et résonnent, m’échappent et prennent possession. Et cela devient parfois compliqué quand on partage sa vie avec quelqu’un, ou un logis avec des ami.e.s, une famille, le temps d’un week-end, d’une semaine. Où on est susceptible de se faire interrompre toutes les 5 minutes pour un oui pour un non. Pour avoir un chien collant, je redoute déjà le moment où j’aurai des enfants pour ça !
Pour contrer cela au quotidien, j’ai plusieurs solutions.
La première, c’est de ritualiser. Avec mon mari, nous avons convenu que certains soirs, les films ou séries devraient être courts, pour me laisser le temps d’écrire, entre 21h30 et 22h30. Le thé est lancé, la bougie odorante faite maison allumée : que personne ne me dérange, c’est sacré ! Parfois les aléas compromettent mes attentes (à commencer par la fatigue engendrée par le travail et les réveils à 6h du matin pour affronter les embouteillages genevois). Mais c’est mon temps. Il m’est dédié, à moi, à mes projets. Je coupe le téléphone, le chien pionce, je suis dans des conditions propices.
L’autre moment où je suis très productive, c’est quand je me rends dans mon petit salon de thé. Les trois dernières années, je m’y rendais entre deux consultations à domicile car il était sur mon chemin. Et je me bloquais une heure, juste pour écrire. Avec ma petite table (je deviens très grognon quand d’autres clients la prennent). Le gérant me connaît par coeur. Savait à quelle heure j’arrivais. Mon thé attendait presque sur ma table avant même que je m’installe. Casque vissé sur les oreilles, odeurs de gâteaux tous justes sortis du four et autres fragrances végétales, trou noir de réseau : le paradis pour écrire. Je n’ai rien d’autre à faire, pas de distraction. Juste moi, ma musique, mon thé et ma page Word. Aujourd’hui, j’essaie de maintenir le rituel, mais le salon de thé est assez loin de chez moi et j’ai moins le temps en journée pour m’y rendre.
Et puis, le plus grand des luxes, ça reste les retraites d’écriture. J’en avais déjà longuement parlé dans la newsletter du mythe de l’écrivain solitaire. Partir, loin de tout, s’isoler, dans une tiny, dans une cabane, avec ou sans ami.e.s auteurices. Se payer le temps, littéralement. Tout dépend où, tout dépend comment. Parfois faut-il s’en donner les moyens. Se libérer des contraintes professionnelles, familiales. Se plier à celles, financières. Mais je sais que j’en avais culpabilisé, lors de la dernière. Me dire “meuf, tu te sens obligée de payer et de prendre des congés, juste pour écrire. A quel point c’est élitiste ? Ou classiste ? Payer. Du. Temps. Parce que dans ta vie de tous les jours, tu n’en es pas capable.” Au final, je pense que la configuration où je m’y retrouve le plus, c’est la “simple” retraite d’écriture entre copaines auteurices, chez l’un.e d’entre nous. Chose que je n’ai pas faite depuis… 2020. Et ça me manque. (parmi mes potes auteurices, qui est prêt.e pour s’organiser un petit truc ?).
✨ Mesurer le temps par compétitivité
Mais parfois, en écriture, le temps peut aussi devenir mon allié. Aussi étrange cela puisse-t-il paraître. Se donner des défis. S’organiser des wordswars : c’est-à-dire écrire le plus de mots possibles en un temps donné. A nous (parce que oui, plus on est de participant.e.s, plus ça motive !) de déterminer le temps accordé. 10 minutes. 15. 30. Jusqu’à une heure pour les plus valeureux.ses. Mais le fait de cloisonner l’activité d’écriture sur quelque chose de très intense, c’est challengeant. On a tendance à dire que l’écriture est un marathon. Une épreuve sur le long-terme. Ecrire est une passion ingrate. Les résultats mettent beaucoup de temps à émerger, et souvent, ils se concrétisent assez peu. Ici, c’est tout l’inverse qu’on tente d’inculquer. Tant pis si ton chapitre est décousu ; tu écris avant tout. Pas de retour en arrière, pas de perfectionnisme. On y reviendra plus tard. Pour l’instant, l’important, c’est la matière première, c’est l’acte-même de la création, c’est compter les mots. Quantifier l’inquantifiable, mettre un peu de mathématiques dans la littérature. Quitte à refaçonner plus tard.
Je sais que ces challenges, dérivés du NaNoWriMo (événement sur novembre consistant à écrire 50000 mots en 30 jours) ou du défi sablier, m’ont beaucoup motivée. Dans le sens m’ont mis de sacrés coups de pieds dans le fion. Le temps devenait un professeur. Un allié que l’on considère au départ comme un ennemi perfide qui ne veut que nous humilier, mais qui nous permet d’apprendre nos meilleures leçons. Parfois au fer rouge. Mais comme dans le Petit Prince, tout est question de s’apprivoiser.
On en sort une certaine fierté. De se dire qu’on l’a fait. Qu’on a “battu” le temps. Une revanche sur toutes ces années où il nous a dépassé. Enfin, on se sent maître.sse de son cours, mieux, on joue avec lui.
Je pense que ces expériences de mesure du temps pour me challenger m’a permis d’acquérir une discipline certaine qui m’a, par la suite, permis de me cadrer en tant qu’autrice professionnelle. Oui oui. Vous voyez où je veux en venir. Nous allons parler du cauchemar des auteurices.
Les deadlines.
✨ J’aime les deadlines ❤
Ca peut faire peur, dit comme ça, pourtant c’est vrai.
J’ai découvert les deadlines bien avant mon contrat d’édition avec Hachette Romans, puisque l’autoédition est aussi question de timing et d’organisation. Quand j’ai organisé ma première campagne Ulule en octobre 2016, je savais que je voulais publier les deux premiers volumes de ma saga en mai 2017. Cela a demandé beaucoup de rétroplanning. Savoir à quelle date envoyer les fichiers à l’imprimeur ; donc aux correcteurices pour leur laisser le délai nécessaire. J’ai cravaché comme une forcenée pendant le mois de janvier 2017 dans mon nouvel appartement fraîchement acquis pour envoyer les fichiers à la fin du mois. Cela m’a donné un objectif concret.
Cela m’a rappelé mon travail. Car en ergothérapie, on construit ce qu’on appelle des objectifs SMART avec les patients :
Spécifique ; le but est clairement établi, pas trop large,
Mesurable ; ce n’est pas vague,
Atteignable ; ne pas proposer l’impossible.
Réaliste ; on reste dans la même idée.
Temporel ; qui est fixé dans un temps donné.
Là, ici, dans notre cas présenté : réécrire et corriger entièrement deux livres en trois mois. Et je l’ai fait.
Par la suite, j’ai eu d’autres deadlines, à commencer par celles établies par les contrats d’édition d’Hachette Romans. J’ai toujours réussi à les tenir, même si certaines étaient plus difficiles que d’autres (comme renvoyer des avis sur corrections sur un temps réduit). Disons que sur les gros travaux (des parties d’écriture et de réécriture), je me sentais même davantage en avance. Ce qui pouvait parfois désarçonner en face.
La balance a changé avec mon nouveau contrat avec Slalom. En janvier 2024, je leur propose mon dossier de synopsis. Un projet se détache. J’envoie les premiers chapitres et le synopsis “complet” (mes synopsis ne ressemblent jamais à rien. Ils sont bardés de “là, y aura une scène. Je sais pas quoi, mais y aura !” #vismavied’autricepasarchitecte) dans la foulée. Je reçois le “oui” en avril 2024. Et chose peut-être atypique, mais c’est moi qui ai fixé ma deadline. Octobre 2024 me paraissait atteignable. J’ai pu déterminer mes besoins et mes capacités grâce à mes expériences. Grand bien m’en a fait. Je me suis sentie libérée des contraintes, portée par la confiance de mon éditrice. Fin août, mon premier jet était terminé, ce qui m’a permis de retravailler le texte pendant tout le mois de septembre avec mes bêta-lecteurices. Tout s’est passé comme sur des roulettes. Je dois actuellement boucler mon travail édito, qui aurait pu se clore sur les bonnes dates, si je n’étais pas tombée malade. Car oui, parfois, les imprévus bouleversent tout. Je ne les prends pas en compte dans mes calculs de dates, car ça me laisse, je trouve, trop d’opportunités pour procrastiner s’ils sont trop importants. J’aime me fixer un temps à la fois raisonnable, mais un peu challengeant quand même. Et pour Rosaces & Dragons, c’était juste parfait. J’ai passé un temps d’écriture et de retravail de qualité, c’était idéal.
En octobre, j’ai eu un rendez-vous avec un autre éditeur (ouuuuuuuh, quel mystère !), pour discuter ensemble d’un projet. Pareil, j’ai fixé moi-même mes deadlines. Première partie de manuscrit pour fin novembre-début décembre, et espérer envoyer le manuscrit entier d’ici fin mars. C’est ça qui me correspond. Garder le contrôle. Je sais que certain.e.s copaines auteurices s’angoissent des deadlines, préfèrent écrire sans contrainte. Je les comprends. Mais me concernant, j’adore ; tant que c’est moi qui les fixe. Cela me permet de me cadrer. De m’organiser. Je suis l’autrice ; je me connais ; je sais comment JE peux me gérer dans un temps donné. Même si l’éditeurice a ses contraintes, je ne me plierai pas à toutes les exigences si je pense qu’elles ne sont pas réalisables dans le cadre de ma vie. C’est-à-dire la vie d’une soignante qui travaille 35h semaine avec des salons les week-end.
Si les éditeurices exigent un délai plus court, à ce moment-là, peut-être faudrait-il songer à rémunérer davantage les auteurices pour qu’iels puissent se libérer du temps par rapport à leur emploi, sans perdre en sécurité financière. Non. Les auteurices n’ont pas à travailler nuits et week-ends pour le confort de leurs éditeurices salarié.e.s qui, parfois, mettent 8 mois à faire des corrections qu’iels promettent de renvoyer mois après mois. Même si je suis également consciente de la charge de travail dont iels écopent, cependant, pas au détriment de leurs auteurices qui ont leurs propres vies et qui souhaitent cesser le bénévolat sur leur temps libre pour des questions de manquements. Mais je considère qu’on n’a pas à se contorsionner en origami-style pour bien se faire voir. Le respect des deadlines, c’est à double-sens. De ce fait, accepter la flexibilité, les imprévus, c’est aussi à double-sens.
Cela fait quelque temps (bien que cela soit encore assez récent à l’échelle de mon parcours) que j’ai remis en cause le schéma ascendant de l’éditeurice sur l’auteurice. Nous sommes collègues, collaborateurices, partenaires autour d’un projet professionnel créatif, avec parfois une certaine forme d’affection qui se développe, mais en aucun cas l’éditeurice ne sera mon.ma supérieur.e. Oui, iel aura sûrement raison sur certains points, beaucoup plus d’expérience sur d’autres et son expertise m’aiguillera justement dans la création de mon oeuvre. Mais iel n’a pas à me dicter mes habitudes d’écriture que j’estime nécessaires pour obtenir un résultat à la hauteur. C’est de ma responsabilité professionnelle. Un contrat envers moi-même. Une conscience de ses propres compétences et limites. Et je trouve ça sain. Peut-être est-ce idiot, mais si j’étais éditeurice, je me sentirai plus en confiance avec un.e auteurice qui me dit “ah non, mars, ça sera pas possible. Juin, c’est envisageable.”, que quelqu’un qui me dit “mars, ça sera difficile, mais oui oui ! Je le ferai ! Oui oui amen !” pour au final récupérer un manuscrit en juillet, de la part d’un.e auteurice en burn-out, qui déteste son propre manuscrit.
Il faut ARRÊTER d’associer l’écriture à la souffrance. A une espèce d’exorcisme masochiste. Pire. D’associer la qualité d’un livre à la torture que son écriture a signifié. “Alala, j’aime mon livre, mais je le déteste en même temps !”. Il y a un côté auteurice torturé qui rappelle nos époques de littérature romantique, de cellui qui écrit avec son sang à la lumière de sa bougie en suie noire et sous les cris des corbeaux, mais je vous assure que de l’extérieur, c’est absolument pas glamour. Oui, parfois, on souffre de l’écriture, mais c’est surtout (et ça devrait être) un plaisir. Sinon, remettons-nous en question. Vraiment. Pour notre bien-être, pour notre santé mentale. Questionnons le lien avec les éditeurices, avec nous-mêmes. Mais il faudrait cesser de romantiser la souffrance des auteurices. Prenez une pause et respirez un grand coup.
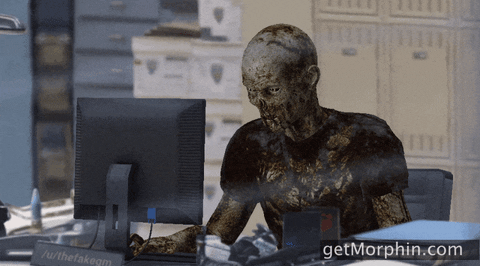
D’ailleurs, ce sont toutes ces deadlines qui ont causé le retard de cette lettre. La priorité sur mes manuscrits, surtout quand il est question d’édition derrière, est bien plus importante que ma newsletter. Comme énoncé, ça reste une responsabilité professionnelle. Oui, écrire un tiers de roman en 1 mois et demi tout en reprenant un nouveau travail, planifier de le finir 4-5 mois plus tard, ce n’est pas rien ! Mais comme je suis en attente de la suite et de mes prochaines directives, je suis “libre” de pouvoir écrire ce que je veux pendant mon temps libre. Et cette lettre en fait partie.
✨ Date de péremption des auteurices
Pour rester sur le thème du temps, il y a un constat que je fais, avec l’avènement des réseaux sociaux livresques, comme Bookstagram et Booktok : publier le plus vite possible, le plus tôt possible. Oui, éditer était aussi mon rêve quand j’étais ado. Mais ça me paraissait en même temps inatteignable. Et aujourd’hui, combien de jeunes femmes de 18-19 ans vois-je espérer un “oui” à leur premier roman commencé 1 an tout juste en arrière ? Tout me semble aller si vite.
Certains parcours sont impressionnants, à commencer par celui de mon amie et collègue Margot Dessenne qui a accompli le rêve de beaucoup : publier sa trilogie dans une maison d’édition prestigieuse en terme d’objets-livre et de distribution avant 25 ans en gérant sa communication comme l’experte qu’elle est. Mais ces mêmes beaucoup ne comprennent pas toujours qu’il s’agit ici d’une figure d’exception, qui a un parcours tout à fait admirable et impressionnant. Ce qui amène justement ces toujours mêmes beaucoup à penser que, s’iels n’ont pas publié leur premier roman avant 25 ans, ce sont des auteurices raté.e.s.
Ce qui est entièrement faux. Au contraire, c’est sain.
Si vous me suivez sur Threads, j’avais un jour lancé le sujet. Non, s’échiner à vouloir publier son premier roman n’est pas toujours une bonne idée. Ce sont généralement nos terrains d’expérimentation. Nos premiers pas chancelants. Quand on est auteurices, il y a plusieurs phases, par lesquelles je suis passée, et que j’analyse très (très) grossièrement ainsi :
Les deux premières années d’écriture : c’est le temps de l’innocence et de la découverte. On invente, on crée, on s’inspire. C’est l’effervescence. On part de zéro, il y a tout à apprendre !
Entre 2 et 5 ans d’expérience : c’est le temps de l’excès de confiance. On pense tout connaître. On se croit pro. On donne des conseils à tout va. On se sent en capacité de juger les autres et leur travail, sans jamais nous-mêmes nous remettre en question.
Entre 5 et 10 ans : c’est le temps du doute. On comprend qu’on n’a raconté que de la merde pendant la période de la confiance. Que ce qu’on pensait merveilleux et révolutionnaire dans nos textes est en réalité absolument fade et cliché. Alors après une période un peu hangover, il faut décider de se reprendre en main, d’accepter ses défauts pour mieux les surmonter.
Après 10 ans : c’est le temps de l’humilité. On a pris beaucoup de recul. On a engrangé beaucoup de connaissances, mais on reste modeste. On n’est jamais à l’abri de faire encore des erreurs (et on en fait encore ! On en fera toujours !) On aurait envie de donner des conseils, mais on ferme davantage sa bouche que par le passé, parce qu’on sait très bien qu’un conseil en écriture ne marchera pas pour tout le monde. Car nous sommes tou.te.s des auteurices différent.e.s. On assiste à la naissance des jeunes auteurices, qui passeront elleux aussi par la période d’excès de confiance, mais on ne dira rien : chacun.e ses expériences. Il faut passer par là, cela fait parti du process. Les obstacles, les échecs. Pour apprendre à rebondir.
Il faut à tout prix retirer l’idée de la tête des jeunes auteurices qu’on doit ABSOLUMENT publier son premier roman, dans les 5 premières années d’écriture de surcroît. Car certain.e.s éditeurices en profitent justement. Pour contrôler, manipuler, tourner à leur avantage, exploiter, en profitant des faiblesses et des failles dont les auteurices n’ont pas encore conscience. En brandissant ce “oui” en forme de carotte, de nombreux abus ont lieu dans le monde de l’édition.
Dans cette quête de la publication, croyez-moi, le temps sera votre ami. Laissez mûrir votre écriture. Multipliez les projets. Ne vous arrêtez pas aux premiers. Ponctuez vos années, les périodes de votre vie, de plein de projets différents qui donneront le “la”. Personnellement, quand je me figure les années 2000, je pense “Fleurs d’Opale”. Quand je me figure les années étudiantes, les années 2010, je pense “Ludo Mentis Aciem”. Quand je réfléchis à la première moitié des années 2020, c’est “Persona” qui m’a guidée. Et qui sait quelles nombreuses autres ensuite. Et c’est peut-être pour cela que j’ai du mal à corriger Ludo Mentis Aciem pour proposer une version imprimable ; je me dis que cette oeuvre appartient au passé et qu’elle est très bien là où elle est. Ancrée dans cette époque. La ramener à la vie en 2025 n’aurait, au final, que peu de sens. Comme ressusciter un zombie qui n’a plus sa place dans le présent. Même si je l’aime profondément et que je la considère comme l’œuvre avec l’intrigue la plus incroyable et complexe que je n’ai jamais conçue. Elle a fait de moi l’autrice que je suis aujourd’hui.
Mais publier à 17 ans n’est vraiment pas le flex que vous croyez. Et qu’on ne me dise pas “ouiiii mais regarde Christopher Paolini, il a écrit Eragon à 13 ans !”. Oui, mais les parents de Christopher Paolini étaient les créateurices d’une maison d’édition, iels ont publié les écrits de leur propre fils quand celui-ci a eu 19 ans (et selon certains sources, il aurait eu l’idée, mais ce n’est pas entièrement lui qui aurait écrit les premiers tomes). Et nom d’une pipe en granit brut, qu’on arrête aussi les “noN mAis ROwliNg, ellE a éTé refUséE 14 fOiS, les éDiTEuriCes qUi onT diT NoN doiVEnt s’aRraCher les ChEveuX !” chaque fois qu’une auteurice annonce qu’iel a eu un nom. Ceci est une exception. La preuve ? OK. Citez-moi un.e autre auteurice à qui c’est arrivé. Hm ? Personne ? Oui, pourquoi toujours ce même exemple ? Fort bien. Arrêtons de fantasmer sur des EXCEPTIONS. Considérons la norme du “non”, la norme de “l’attente”, la norme du “dixième roman écrit = premier roman publié”, la norme de “premier salon à 35 ans”. C’est OK ! Certes, c’est beaucoup moins impressionnants que les exceptions, mais c’est justement ce à quoi nombreux.ses sont voué.e.s. Le culte de l’exception nous rend dingues et nous force à considérer le temps autrement que comme un allié qui forgera notre plume. Normalisons les échecs et les rebonds, c’est ça qui inspire !
L’écriture, l’édition, n’est et ne doit JAMAIS devenir une course ! Contre le temps mais contre nous ! Se dire que commencer à écrire à 30 ans, c’est “trop tard”. Rien n’est jamais trop tard.
✨ Prendre le temps à travers l’écriture
S’il y a une raison pour laquelle j’ai du mal avec les traductions anglosaxonnes à la mode, c’est que la langue anglaise et le style lié à la fantasy young adult sont directs. Visuels. Efficaces. Rythmés. Je vous vois cligner des yeux, à vous dire “OK, et c’est quoi le problème ?”
On ne prend plus le temps. Le temps de décrire. Le temps de comprendre. Le temps de faire réfléchir les lecteurices. Le temps de jouer avec les mots. La langue française est d’une richesse vertigineuse. Et si on m’avait dit 20 ans en arrière que ce que je détestais faire au collège-lycée, à identifier les figures de styles dans des textes classiques, deviendraient mon péché mignon dans les œuvres francophones actuelles. Il en émane une poésie sans nulle comparatif. Moi-même je m’amuse des allitérations et des effets que procurent les sons, les significations, les oblitérations. Tout est question d’équilibre. L’écriture n’est parfois finalement qu’un ensemble de recettes de cuisine sur lesquelles on innove. Tout doit être dosé. Parfois, on recommence, ça ne marche plus aussi bien.
La littérature “hype” du moment est divertissante, efficace. Elle fait l’effet d’un film Marvel. C’est ce que je remarque : les livres qui ont le plus de succès présentent des aventures “standard”, avec des romances (hétéronormées) comme il en faudrait. Sans ce petit “plus” qui fait passer du “good” au “waoh”. Comme une annonce d’astrologie très conforme et qui correspond à tout le monde. On se contente de ce qui satisfait le plus grand nombre sans prise de risque, sans renouvellement, sans franchissement des frontières.

Où est la didactique ? Les interprétations personnelles ? Les personnifications ? Les métaphores ? La place aux hypothèses, aux fins ouvertes ? Les reflets de nos quotidiens, transposés dans la fantasy ? Ces prises de position qui, à la fois, font clivage et marquent au fer rouge ? Que retiendra-t-on de ces livres, dans 20 ans ?
Sûrement est-ce ma manière de considérer mes propres lectures. Il est vrai que je préfère les lectures qui me font réfléchir, sans être de la branlette intellectuelle pour autant. Des lectures qui peuvent me sortir de ma zone de confort, m’étonner, me forcer à réfléchir autrement. Qui, finalement, me font “grandir” en tant que lectrice. Et les lectures francophones y parviennent mieux à mon égard. Certaines oeuvres traduites aussi, bien sûr, mais pas une majorité. Car, justement, on prend le temps. D’installer une ambiance, de caractériser, de jouer avec les mots, de donner Vie. Sans pour autant s’appeler Balzac. Je retiens quelque chose une fois la dernière page close.
De nouveau, tout est question d’équilibre. Back in time, en 2010, je m’amusais à insérer des mots inconnus au bataillon dans les Fleurs d’Opale. Pour me donner un genre, pour apprendre des choses aux lecteurices. Moi-même je ne comprends plus trop mes intentions derrière. Je regarde la moi de 18 ans avec un regard circonspect. Mais cela fait partie des fameuses expériences dont je vous ai parlées. Désormais, tout doit avoir un sens. Une description, une comparaison. Bien calée, bien mesurée, pour optimiser l’effet. Et comme vous vous doutez, le temps, on le réclame aussi en tant qu’auteurices pour travailler tout cela. Travail souvent inconscient, soit, mais travail quand même.
✨ Le thème du temps dans mes romans
Je termine cette lettre thématique sur une incursion analytique de mes romans. Car c’est toujours intéressant de se soumettre à l’exercice (n’hésitez pas d’ailleurs à le faire sur vos propres histoires !).
Hormis dans LMA, je n’ai jamais abordé le thème du retour dans le temps. Trop casse-gueule pour moi. Cependant, s’il y a bien quelque chose que j’adore, avec ces bonds dans le passé, ce sont les flash-back. Je crois que toutes mes histoires y ont le droit ! Un petit (gros) regard sur le passé de certains personnages, pour mieux comprendre leurs personnalités et leurs enjeux actuels. Cela permet de résoudre des mystères, de rendre des personnages plus attachants alors qu’iels étaient jusque-là imbuvables (coucou Eloïse). Même la figure maléfique de l’Edile de Persona aura le droit au sien (ohhhh boum, le petit spoiler !). Les flash-back donnent d’incroyables perspectives et c’est vraiment mon péché mignon ! Même si je sais qu’ils coupent parfois le rythme de l’intrigue.
Dans Persona, d’ailleurs, le temps devient un personnage à part entière. Notamment dans le tome 1 et à partir du tome 3. Dans le premier, car l’intrigue se passe en cinq jours. Les personnages doivent absolument kidnapper le fiancé de la princesse avant la date fatidique du mariage. Au moment des corrections édito, nous avions imaginé avec mon éditrice des en-têtes de chapitres avec une clepsydre illustrée qui fait le décompte des heures/jours restantes. A partir de la fin du tome 2, quand les personnages comprennent que leur monde est en sursis à cause de la menace de Vespera, l’Ombre qui engloutit le continent et grossit jour après jour, le temps revêt le rôle d’antagoniste. Une course contre la montre constante. Et qui donne un sursis à Andrea. Car Andrea est un personnage qui se laisse voguer avec le temps. Iel rêvasse, fait des grasses matinées, compose des musiques, des poésies. Pour repousser le moment où iel devra définir son identité, comme une fuite du temps à travers ses créations d’esprit et ses masques. Vespera est son propre compte à rebours. Si la saga s’appelle Persona, c’est qu’elle se concentre justement sur la transformation d’Andrea en son réel ellui, qui se révélera à la toute fin. Sa recherche d’identité à travers le temps, et qui finira par percer le temps… Peut-être que cela vous paraît très abscons. Très tiré par les cheveux. Mais je vous assure que cela prendra son sens à la lecture de la conclusion (qui j’espère sortira un jour. Bientôt).
Dans mon prochain roman, Rosaces & Dragons, le temps joue aussi un compte à rebours, mais dans le sens inverse. Certes, une menace place aussi sur Arc-en-Flammes, mais sa résolution signera la fin de l’aventure. Et donc la fin de la relation entre les deux personnages principaux. Un véritable dilemme.
Le temps qui guérit les deuils. Qui affecte les relations. Il y a tellement de manière de l’interpréter.
Par exemple, dans Serment de Noirceur, mon prochain encore, qui parle de sorcières, l’intrigue se déroule sur plus de 25 ans, divisée en trois actes. Le temps change les personnages, leurs dynamiques, leurs enjeux. Et dans un futur projet de fantasy adulte, La Dernière Enlumineuse, le temps est encore plus personnifié, puisque la protagoniste voit son artisanat disparaître avec le temps, avec les modes, les courants, la technologie, elle-même terrifiée de sa propre “péremption” alors qu’elle vient de franchir le cap des 35 ans, célibataire, avec un chien, terrifiée par la vie qui s’affole autour d’elle. Et des incessants comparatifs : qui a “réussi” sa carrière ? Ses investissements financiers, immobiliers ? Qui a fondé une famille ? Qui a accompli ci ou ça ? (justement ! Qui a publié avant 35 ans ? Ahaha)” après une enfance/adolescence/jeune adultisme assez standardisé.e.s, où on passe tous par l’école au même âge, avec les mêmes modes, les mêmes examens, les mêmes codes étudiants ? Cet âge où le temps cesse soudain d’être codifié et où tous les repères se perdent.
Le temps est-il finalement un ami ou un ennemi pour mes personnages ? J’ai l’impression que tou.te.s apprennent à l’apprivoiser au fur et à mesure. C’est peut-être ça, la leçon que je devrais en tirer. Que j’ai commencé à appliquer dans ma manière d’appréhender l’écriture avec les deadlines, et que je devrais étendre à la vie en général. Ne pas le sous-estimer, ne pas le fuir, juste apprendre à vivre avec lui pour savourer le moment présent, sans s’enfermer dans le passé, sans fantasmer ou craindre un hypothétique futur.
Et c’est peut-être ce que je vous souhaite de meilleur : être en paix avec le temps.
Joyeuses fêtes, les lucioles ! 🎄🌟
✨ A venir
Pas d’événement en janvier-février. Je suis en pause de dédicaces jusqu’à mars (sauf si surprise pour Yggdrasil Lyon !).
J’essaierai de rédiger une autre lettre pendant mes congés, que je publierai sur la première moitié du mois de janvier. J’ai plein d’idées de thème, mais pas encore de fixé. Si vous avez des envies, n’hésitez pas à les noter en commentaire !
Et pour ma recommandation du moment, je serai probablement une très mauvaise personne si je ne faisais pas écho par l’ouverture de cette lettre : Arcane. (disponible sur Netflix)
Je sais que l’univers duquel est tiré la série en rebute beaucoup. Moi non plus je ne nourris pas un amour particulier pour League of Legends. Au contraire. Mon ex m’a trop souvent négligée en faveur de ce jeu qui avait aspiré sa vie. Mais cette série animée est incroyable. De par son animation (chaque frame est un véritable chef d’oeuvre) et ses personnages haut en couleurs. En terme d’écriture, c’est une masterclass, mais si on peut regretter un rythme trop rapide sur la saison 2 et un manque cruel d’explications qui m’a donné l’impression d’être vraiment stupide. Mais la dynamique entre les personnages, leurs enjeux si divers et pertinents, toujours raccords, la créativité des inventions, des concepts, des plans, la musique qui vibre tellement avec l’image qu’elle en devient organique. Les scènes qui prennent aux tripes jusqu’à t’en tirer des larmes. Cette série est intelligente et elle te le fait savoir. Ce n’est justement pas qu’un simple divertissement ; ses messages cachés sont infinis et la grille de lecture digne d’un excel. Je pense que je me ferai une autre lecture bientôt, juste pour savourer tous ces détails que je n’avais pas saisi à mon premier visionnage.
Et aussi pour Vi. Ahaha. Mais qu’est-ce que ça fait du bien, une série avec une diversité assumée, sans passer par des traumas dump et des coming-out à tout va. Mais au final, je les aime tous. Jinx est complexe, Jayce est surprenant, Viktor est touchant, Mel est puissante, Catlyn est déterminée… et VI EST SEXY. Pardon.
Sur ces belles paroles, passez de belles dernières journées de 2024, vous souhaitant de meilleures encore pour 2025, avec l’accomplissement de tous vos rêves !