Ecrire l'amour pour mieux le conjuguer
Un jardin de romances hétéronormées et de magnifiques mauvaises herbes
A l’approche de la St Valentin, beaucoup de couples (dont le mien) sont en panique. Defcon1. La pression sociale et commerciale autour de cette date pourtant banale, ni plus ni moins différente qu’une autre, est aliénante. Mon mari étant de janvier, j’ai déjà dû me creuser la tête pour lui trouver des cadeaux pour les fêtes, pour son anniversaire (et sachant que j’aime bien lui offrir aussi des cadeaux sans raison sans motif) ; bref, pas le temps de niaiser ! Un cadeau pour lui ? Ou pour nous ? Petit ou gros budget ? Les injonctions autour de cette fête sont délirantes et souvent hors propos. Il faut offrir des fleurs. Mais pas des roses, c’est pas écolo. Il faut se consacrer du temps à deux. Mais tu t’en consacres déjà tous les jours. T’aimes pas les coeurs ? Ou le rouge ? On s’en cogne. Parcourant les sites internet, on doit slalomer entre les tenues “sexy” et les jeux pour deux (spoiler : c’est pas un Skyjo), bref, si tu aimes, il faut b**ser. Pas d’espace pour la nuance, pour les personnalités de chaque couple, de chaque relation.
Faites semblant d’être heureux à deux, et faites pas chier.
C’était un peu l’impression que j’avais eue en février 2011, lorsque j’avais fait comprendre à l’un de mes ex que j’aurais bien voulu une petite attention sympa pour cette occasion (en plus, c’était notre première St Valentin. Ma première expérience en tant que personne enfin majeure, bref, ma première St Valentin “d’adulte”). Il a acheté une rose à contrecœur, me l’a offerte sans un oui, sans un merde, et m’a emmené dîner… au Subway d’en face. En me tirant la gueule. J’avais payé pour deux. Hormis le fait que c’était un con fini (j’ai quand mis quasi un an pour le larguer ensuite), cet épisode m’a fait comprendre que l’amour n’est pas celui des grands films romantiques. Notamment quand tu décides de relationner exclusivement avec un homme. Il m’a fallu du temps pour comprendre certains mécanismes liés à ces relations qui, pourtant, occupent, voire conditionnent, un genre entier de la littérature. Pour tout avouer, je ne m’en suis toujours pas démêlée.
Et là-dessus, la lecture et l’écriture m’aident BEAUCOUP à appréhender l’amour AUTREMENT. A l’explorer, véritable, sincère, ou manipulé, nuisible. En besoin de compromis, d’écoute et de respect. A deux, ou plus. En couple, en amitié. En famille, avec des êtres chers. Envers soi-même. Et c’est ce que je vous propose comme thématique aujourd’hui. Celui qui a fait couler autant d’encre que de sang : l’amour.

Avant de débuter ce blabla-guimauve option fromage et GIF de qualitey, quelques petits rappels bien utiles. Du haut de mes 32 ans, je ne peux pas affirmer que je connais tout de l’amour (et j’estime même que certaines personnes plus jeunes que moi écrivent mieux l’amour encore, comme quoi l’âge ne fait pas tout), mais j’essaie de le retranscrire tant bien que mal dans mes histoires depuis 2006. Autrice de l’imaginaire, j’ai varié les expériences au sein de mes romans. Une fois par mois environ, j’aime bien parler d’un thème en particulier, autour de l’écriture, de l’édition, en le recoupant toujours avec ma petite expérience, mieux, en la sourcant quand cela est possible. L’idée étant d’ouvrir, dans cette newsletter, un espace de réflexion pour chacun.e. Croiser nos regards, partager nos vécus, autour d’une passion-travail commune.
Vous êtes désormais 851 à suivre ce ✨blabla qui chatoie✨ et je vous remercie d’être chaque fois plus nombreux.ses à suivre ces lettres, débordant de GIFs en tous genres. Votre confiance et votre fidélité me vont droit au coeur, ainsi que vos retours quand vous me partagez en contrepartie vos propres expériences. Ravie de voir que mes idées engagées ne vous ont pas fait fuir (pour l’instant !).
Le petit rappel toujours essentiel, auquel je ne me dérogerai jamais : cette lettre ne concerne que mon unique avis, qui n’est, par définition, pas objectif. Je n’ai pas réponse à tout, j’ai probablement tort sur certains points, et tant mieux : il n’y a que les cons qui ne changent pas d’avis. Mais si j’ai toujours du mal à exposer mon point de vue à l’oral, considérons que cette newsletter est l’espace pour enfin l’ouvrir. Et advienne que pourra ! Mais mon opinion n’est pas argument d’autorité.
Et comme d’hab, cette lettre est BEAUCOUP trop longue pour rentrer dans un mail, n’hésitez pas à l’ouvrir dans l’application !
Sur ce, commençons ?
✨ L’amour au centre des premiers récits animés
Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants.
Qui n’a jamais lu cette phrase qu’on nous a servi à outrance dans mille contes ? La finalité d’une histoire, c’est un mariage, des enfants en bas-âge. Et. Ta vie d’aventure s’arrête là. Ensuite, tout héros est périmé. Condamné à une vie morne jusqu’à ce que mort s’ensuive. Une obsolescence émotionnelle programmée. La BELLE récompense de la vie, iel l’a déjà eue. A 20 ans, avec l’amour. La relation crée l’histoire. La rencontre, le rapprochement, les péripéties, les rédemptions, les écoutes, les incompréhensions, pour terminer sur le seul, l’unique et indéfectible, engagement à vie.
Enfant des années 90, j’ai évidemment grandi avec les Disney, notamment avec la génération de princesses de cette époque. Belle, Ariel, Mulan, Jasmine… Ou même celles qui leur sont antérieures, comme Cendrillon, Blanche-Neige, la Belle au Bois Dormant. J’ai fait l’analyse. Sur les 46 films d’animation Disney (je n’ai pas compté les Pixar) que je connais relativement bien, 25 d’entre eux comportent une histoire d’amour romantique “centrale”, dans le sens où le couple se rencontre pendant le film ; se rapproche ; finit plus ou moins ensemble à la fin. Soit 55% des films qui suivent ce schéma. C’est. Enorme ?

Certains mixent différentes formes d’amour, comme Rox et Rouky, qui va davantage explorer la thématique de l’amitié, même si Rox trouve sa renarde sur le dernier tiers. Il y a eu, dans les années 2000, une bascule, dans la tentative de renaissance de la franchise, avec des dessins animés comme Kuzco (amitié et famille), Lilo et Stitch (soeurs avec écart d’âge), la Planète aux Trésors (père et fils spirituels), Frère des Ours (lien fraternel). Qui n’a pas accroché plus que ça… Malheureusement. J’ai personnellement beaucoup aimé ces films d’animation.
Jusqu’à la Reine des Neiges, qui a voulu faire péter les clichés, jusqu’à les dénoncer voire les parodier (“on n’épouse pas un homme qu’on vient de rencontrer, voyons !”), afin de mettre en avant d’autres types de relations. Disons que cela a moitié marché, vu que l’une des sœurs va suivre EXACTEMENT le même schéma rencontre-rapprochement-malentendus-bisou final/engagement. Là où ils auraient pu aller jusqu’au bout de leurs idées. Mais est-ce que cela aurait plu au public ? A méditer… Car le public attend justement ça.
✨ “Y a de la romance ?”
Certaines personnes sont en recherche de ce point spécifique. On veut VIBRER, on veut de l’AMOUR ! Et si vous avez déjà écrit un livre et que vous en avez parlé sur les réseaux sociaux, il est très probable qu’on vous ait déjà servi cette question (option sans bonjour ni merde ni merci) : “y a de la romance ?”. Et, majoritairement, les gens qui m’ont posé cette question ne sont jamais revenus vers moi ou mes livres après mes explications (cela concernant surtout Persona, mais on y reviendra plus précisément).
Est-ce un besoin ? Une envie ? Un conformisme ? L’habitude d’avoir toujours eu des supports avec de la romance que leur absence en devient lassante ou sans intérêt ? Je me pose réellement la question. Certain.e.s m’avanceront bien qu’iels ont besoin de romance. Mais précisons bien : hétéronormées. Car dès qu’une romance lesbienne sera avancée, par exemple, cela pourrait moins “intéressant"… : “ça ne me concerne pas, je ne me reconnais pas dedans”. (par contre, les romances entre hommes… *tousse* Il y a du monde au portillon.)

J’ai lu des romances, notamment du temps du lycée, quand je me gavais de fanfictions. Hétéro, gay, lesbiennes. Sans trop de distinction ou d’exigences. Sans jamais rejeter un schéma, une histoire, parce que “ça ne correspondait pas à mes habitudes”. Je nourrissais, je crois, une sorte de curiosité. Une envie de me nourrir de tout, de comprendre, d’expérimenter par le biais des mots des vécus que je n’aurai peut-être pas. Je ne parlerai pas “d’ouverture d’esprit”, mais plus “d’indistinction”. L’importance, c’était le sentiment (et le smut. Qu’on appelait lemon à l’époque). L’intensité. Parfois l’étrangeté. Bref. La nouveauté à tout prix.
Depuis cette époque, je l’avoue, la romance pure et dure, dans le sens un roman qui traite spécifiquement de ce sujet, me laisse plutôt indifférente. J’en suis même devenue ignare. J’essaie de m’y mettre, de tester, mais rien n’y fait, je n’ai plus cette appétence. Parce que je suis méfiante, parce que j’ai peur. J’ai peur d’une relation réchauffée au micro en mode décongélation, avec les mêmes clichés, les mêmes dialogues plats ou cringe. J’ai peur de tomber sur des schémas de domination, de fantasme, d’emprise. Je redoute la déception, la claque de me dire “ce livre est encensé, alors que la relation décrite dedans est malsaine et problématique sur de nombreux points”. Même si cela serait totalement assumé, comme dans de la dark romance, je ne suis pas attirée par ce genre de thématique, même si je peux comprendre qu’il puisse s’agir d’un kink, d’un plaisir coupable, pour d’autres. Ce n’est juste… pas mon genre. Je passe très très certainement à côté de beaucoup de chefs d’œuvres ou de livres qui me plairaient énormément. Mais j’ai du mal.
Pourtant, l’amour, je l’ai écrit. Et pas qu’un peu ! Pas qu’une fois !
✨ Les Fleurs d’Opale, romantasy avant la romantasy ?
Le terme “romantasy” est apparu vers la fin des années 2010. Sa définition n’est pas encore tout à fait claire, mais on pourrait s’accorder sur l’idée qu’il s’agit d’une romance dans un cadre de fantasy (et non pas d’un monde de fantasy avec de.s (la) romance.s). La nuance est mince. Comme tous les genres, il s’agit d’une petite case, d’une étiquette. J’ai fait le deuil depuis longtemps ; savoir que mes romans ne rentraient jamais parfaitement dans des cases. Et c’est OK. C’est moins évident niveau marketing, mais on s’en sort !
J’ai inventé le monde et l’histoire des Fleurs d’Opale en 2006, à cette période où je me nourrissais de romances gratuites sur les internets. Où, lycéenne, je rêvais d’amour inconditionnel, le vrai, le pur, l’éternel. L’âge des premiers baisers, des premières découvertes, le premier pas vers un semblant de vie “adulte”, où on s’empare de son corps et de ses sentiments, comme on peut, dans la tempête émotionnelle que représente le cœur d’une adolescente de 15 ans.
Et, amoureuse des monde de fantasy, je voulais m’affranchir du male gaze. Sans verbaliser mon ressenti à l’époque, car non déconstruite, je percute aujourd’hui, 20 ans plus tard, que j’en avais déjà ma claque. J’avais bouffé des œuvres, des films, où les femmes étaient reléguées au rang d’objets, de désirs, de promesses, sans prendre part à l’aventure en tant qu’héroïnes (même si j’admirais l’aura de Galadriel qui éclipse littéralement son mari et le courage d’Eowyn qui n’a pas besoin qu’on lui dise quoi faire pour buter un cavalier démoniaque millénaire). Des œuvres qui ne passent clairement pas le test de Bechdel. Ce test, souvent nommé pour pointer la misogynie intériorisée au sein de la culture, repose sur trois critères :
Il doit y avoir au moins deux femmes nommées dans l’œuvre ;
qui parlent ensemble ;
et qui parlent de quelque chose qui est sans rapport avec un homme.
Sachez d’ailleurs que les films du Seigneur des Anneaux ne passent pas ce test. Hormis le passage dans le gouffre de Helm : “elle est où maman ?” / “chhhhh”. Ah non, je crois que la gamine n’a même pas de nom.
Et 2006, je voulais écrire mon propre Eragon, mon propre Harry Potter, mon propre Percy Jackson. Mais sans mec en avant. Je voulais une meuf. Qui, soyons honnête, a été, à ses débuts, une énorme Mary-Sue. Je ne vais pas rentrer en détails sur les personnages des Fleurs d’Opale, notamment féminins, car je n’oublie pas ma fameuse lettre sur les personnages féminins (je sais qu’elle est très attendue, et qu’il y a BEAUCOUP à en dire. Elle sera d’ailleurs très sourcée). Mais c’était important pour moi de vous reposer le contexte. Lycéenne qui rêve d’amour ; qui kiffe la fantasy ; qui en a ras-le-cul des héros lambdas. Ca a donné les Fleurs d’Opale.
Au moment de la publication du premier tome, en 2017, j’ai très vite compris que j’allais être freinée par un élément : l’allergie à la romance de certain.e.s lecteurices (la même allergie que j’ai développée en partie aujourd’hui). Si au départ, je présentais l’univers comme une fantasy pure, je me suis très vite retrouvée à préciser “il y a des romances très présentes”. Aujourd’hui, le terme romantasy, même s’il ne colle pas à 300% à cette saga, me permet de donner une idée rapide aux potentiel.le.s acheteureuses de vers quoi iels s’engagent.
Oui, en effet, la romance prend une part importante, mais j’ai testé TELLEMENT de romances différentes. Je vais en parler un peu, en essayant de spoiler un minimum, mais il y en aura ! (si vous voulez sauter ce passage d’analyse, sautez ces paragraphes, on se retrouve un peu plus loin. Je ne vais pas faire toutes les analyses d’un coup).
🌹 Diphtil et Astiran
Il s’agit du couple principal et installé très rapidement. On retrouve ici un Friends to Lovers assez classique, très greenflag pour le coup, puisque Diphtil est une jeune femme romantique tandis qu’Astiran a ses côtés chevalier servant. Et il n’est pas toujours évident de comprendre, pour les lecteurices, que j’ai cherché, par ce couple, à exploiter le thème de l’amour sur la durée. C’est LITTERALEMENT le fil rouge de la saga ! Puisque le roman commence sur leur début d’histoire d’amour (le premier baiser arrive au chapitre 5 ou 6, je crois), et que l’avant-dernier chapitre du dernier volume termine sur la mort naturelle d’Astiran, près de 35 ans plus tard.
Mon objectif était de faire vivre l’aventure non pas à une héroïne, mais à un couple. Voir comment iels allaient, ensemble, traverser les épreuves. Parfois anodines, parfois très cruelles. Comment iels allaient défier ensemble le destin prévu par les Dieux. Et la Grande Déesse elle-même l’explique à la fin du volume I.2 : leur amour était la seule chose qu’elle n’avait pas prévu (car dans d’autres univers alternatifs, ils étaient destinés à devenir ennemis mortels). Bref. Je les ai beaucoup torturés, tout au long de ces quatre volumes, tout en travaillant leurs rôles respectifs, leurs évolutions, et comment leurs sentiments s’ajustent en fonction. Il y a des disputes, des mésententes, des retrouvailles, des réconciliations, du pardon, des compromis. D’autant plus qu’en tant que Déesse, Diphtil est immortelle. Comment se résoudre à vivre, à aimer, sachant qu’elle verra vieillir et mourir l’amour de sa vie ?
Ca a vraiment été très très intéressant à écrire, en terme d’expérience d’autrice, autour du développement des personnages et de leur dynamique. Je pense que les lecteurices qui cherchent de la romance intense seraient un peu déçu.e.s, mais ce n’était pas mon but, à travers elleux. Plutôt de normaliser tous les aspects romantiques. Montrer qu’il existe un après, une suite au “ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants”. En fait, Astiran et Diphtil, c’est peut-être au final vers ça qu’on aspire tou.te.s, mais qu’on ne met pas assez en avant dans les littératures : un couple qui avance ensemble et qui évolue, ensemble, dans le respect de l’autre, tout en gardant cet amour indéfectible. Mais bon. C’est pas sexy. Pas autant que le suivant, je crois…
🌙 Naid et Yasalyn
Clairement le couple chouchou de la saga par les lecteurices, parce que, selon moi, il se rapproche le plus des schémas qu’on retrouve par milliers aujourd’hui. Un bon enemies to lovers des familles, très intense, avec un mec ténébreux et grumpy et une nana très brute de décoffrage et libérée. Dans cette relation, tout se vit à 300%. L’amour, la haine, ce qu’il y a entre. On est sur deux opposés qui ont, globalement, pas grand-chose en commun. A part un tas de traumas respectifs pas loin de la taille de l’Everest. Ca s’engueule, ça baise, ça se sépare, c’est prêt à partir en guerre pour se retrouver. Bref. C’est pas une petite romance pépère.
Pourtant, c’est un couple qui n’aurait clairement pas tenu dans le temps ! S’iels étaient resté ensemble (je dis pas pourquoi ce n’est pas possible, le spoiler est trop gros), leur relation n’aurait jamais duré. Leur couple repose justement sur ce sentiment de vie puissant, tout se fait avec force, voir avec violence. Une pulsion viscérale. Mais la vie quotidienne à deux… Iels auraient fini par se bouffer. Donc oui, même si c’est la romance préférée des lecteurices, car elle éveille des sentiments forts, elle reste, selon moi, très classique dans son écriture. Sa beauté réside dans le fait que leur amour est impossible et est censé le rester, pour toujours, car sa réussite, ou du moins sa réalisation, signerait l’échec de leur romance. Le drame crée tout l’amour entre eux. C’est affreux, dit comme ça.
💃 Isophine et Najira
On est clairement ici sur ma romance préférée de la saga, car on est sur l’entre-deux super intéressant. Dans cette relation, pas de trope. Pas de friends to lovers, d’enemies to lovers, bullies to lovers, clients to lovers, whatever. C’est une rencontre, une approche progressive, un schéma qui finalement est assez classique, mais qui marche malgré tout ! Et c’est beau. Parce que les personnages se découvrent chacune à travers cette relation, notamment la narratrice, Isophine, qui ne va d’ailleurs jamais remettre en question sa découverte de l’amour lesbien, qui l’accepte tel quel, sans s’inquiéter outre mesure, mais qui va surtout comprendre son fonctionnement intériorisé pendant si longtemps.
La relation repose malgré tout sur des ressorts dramatiques. Isophine est une princesse, elle est censée, comme le veut la tradition, fournir des héritiers pour la pérennité de la couronne, donc, logiquement, relationner avec des hommes. Najira, de son côté, est déjà mariée, et, même si son époux accepte sa relation avec Isophine (ouvert d’esprit le monsieur !), elle reste liée à lui et ne pourra pas partir avec Isophine pour rentrer à la capitale. La relation n’est pas parfaite dans sa construction (c’est un constat que je fais après coup), mais elle est belle. Green, dans le respect, dans l’amour, à la fois doux et intense, qui fait ressortir le meilleur des deux femmes. C’est magnifique, c’est pur. Jusqu’au bout. Puisque je raconte dans le “ce qu’ils deviennent” (ma partie préférée des romans ! Car j’explique le destin de chaque personnage après les romans) qu’Isophine, décédant après un règne incroyablement long et rempli, ordonne à ce qu’on prélève son coeur et qu’on l’enterre dans le désert, dans les ruines du temple où elle et Najira se donnaient rendez-vous. Preuve qu’elle ne l’a jamais oubliée.
🐐 Saada et Chain
Dernier couple dont l’histoire est présentée dans la saga, on est ici sur un schéma assez proche de ce qu’on trouve dans les contes. La princesse et le paysan. La différence des classes sociales. Même si Saada est sous couverture et se fait passer pour une fille du peuple. Ici, l’important n’est même pas forcément l’amour, même s’il permet au personnage ses premières découvertes et de s’émanciper, mais d’illustrer les différents points de vue vis-à-vis des autres intrigues. La relation devient un prétexte pour travailler l’intrigue autrement.
Dans cette configuration, j’ai plutôt exploré les émois des premiers amours adolescents, au début timides, puis dévoués malgré certains aspects déraisonnables. C’était amusant à écrire, mais je m’en suis sentie assez détachée. Car je sentais que j’avais passé un cap. Ecrire à 30 ans une relation entre des gamins de 16 ans, tout en sachant que ce n’est pas leur relation émotionnelle l’important, mais ce que leur lien représente en termes de rôles sociaux, ça a mis pas mal de distance. Comme quoi, parfois, on écrit l’amour, mais pas pour raconter l’amour ; seulement pour l’implanter dans quelque chose de plus grand, pour créer un motif, un contexte. Une sorte de tremplin.
✨ Déconstruire 25 ans de préconçus
Revenons à nos moutons. Les relations amoureuses. Nous sommes au milieu des années 2010, j’ai 25 ans, encore célibataire à l’époque, en plein mouvement #MeToo. Certaines amies se radicalisent en regard de certains mouvements féministes. Je commence à entendre parler de patriarcat, de culture du viol. Et là, je commence à me mettre au travail. A lire, à me renseigner, à aiguiser mon esprit critique (d’ailleurs, si vous voulez écouter les cours de zététique de Richard Monvoisin, c’est passionnant et même crucial à notre époque de désinformation, c’est gratuit et c’est sur Youtube), à écouter des podcasts engagés, à suivre des chaînes passionnantes. D’ailleurs, ça me fait un peu peur, côté amour. Je prends conscience que je vais devenir de plus en plus exigeante (et tant mieux !), parce que je sais ce que je vaux, que je veux me trouver quelqu’un de respectueux, d’ouvert, pas un mec-enfant qui voit sa compagne comme une femme de ménage option soirées jambes-en-l’air à son bon vouloir à lui. Je cherche une relation qui ne sera pas de l’amour éphémère, qui s’étouffe rapidement sitôt la “lune de miel” passée, mais un lien de confiance. Ami, amant, partenaire.
Et je commence aussi à considérer autrement les œuvres que je vois. A les critiquer, à remettre en cause des schémas que j’avais intégrés à force d’en avoir bouffé. Bien heureusement, je ne les ai pas digérés. Je continue d’ailleurs ce travail, et nous continuerons. J’ai déjà réussi à mettre en relief les scènes, les dynamiques que je ne veux plus voir/écrire dans les relations romantiques (notamment hétéronormées) :
Les baisers volés > parce que le consentement se fait à chaque étape.
Les baisers de “récompense” > un “merci” suffit.
Les amoureux voyeuristes (le petit coup d’oeil quand une femme se déshabille/est nue) > elle n’a pas donné son autorisation pour qu’on la regarde. [Pop Culture Detective y avait consacré une vidéo]
Il l’aime tellement qu’il est prêt à (la) tuer > l’amour n’excuse pas le meurtre, encore moins le féminicide.
Le “non” entendu “oui” > on ne force pas.
Le chantage affectif sous de gentilles apparences > ça reste du chantage.
Quand un personnage féminin se fait invalider/minimiser son vécu par sa moitié masculine > la base d’un couple amoureux, c’est l’écoute et le respect. Ni l’un ni l’autre ne sont de la partie ici.
Le gentil stalker > ton obsession amoureux n’excuse pas le crime que cela représente.
Le “sombre” protecteur, qui garde la femme sous son aile quitte à la priver de liberté, ou qui fait preuve de violence envers des personnes qui s’en seraient pris à cette même femme > la violence reste de la violence. Et je n’ai pas confiance en un homme qui va préférer mettre une patate à un rival que de réconforter et valider sa partenaire.
Quand il y a notion de “devoir conjugal” > ça reste, dans la plupart des cas, ni plus ni moins, du viol.
Le personnage gros (homme ou femme) qui se force à maigrir / qui devient maigre, sans quoi, iel n’est pas désirable à l’écran > les personnes grosses sont tout autant concerné.e.s par la romance que les autres.
La demande répétée (en date, en mariage) > la persévérance, parfois, c’est pas sexy. Du tout.
On a le droit à un gros plan sur l’objet de désir physique d’un personnage, généralement sexualisé ou érogène (une paire de seins, des pectoraux saillants…) > un personnage ne peut pas être réduit à UNE partie de son corps.
Les expressions stéréotypées type “si un garçon t’embête, c’est parce qu’il t’aime bien” > sous des apparences innocentes, cela véhicule des messages dangereux et excuse de mauvais comportements.
Un partenaire gifle l’autre. > quel que soit le genre.
En parlant de baisers volés, je vous cite d’ailleurs un passage du livre Désirer la Violence de Chloé Thiebaud, dont je vous avais parlé dans une précédente lettre :
Pourtant… j’ai moi-même érotisé ce genre de baisers. “Les scènes de baisers non consentis effacent la dimension problématique en les entremêlant de romantisme”, écrit Célia Sauvage. Le baiser demandé, réclamé, consenti, lui… il m’a longtemps semblé synonyme d’ennui. D’ailleurs, quand j’avais 16 ans, j’ai embrassé celui qui allait être mon premier amour sans sa permission. Je me souviens qu’il m’avait dit quelque chose comme “Eh, préviens avant de faire ça.” Je m’étais vexée, comme s’il m’avait coupé dans un grand élan romantique. Dois-je en vouloir seulement au cinéma de m’avoir appris à “faire ça” ?
Ce passage m’a d’ailleurs fait réfléchir à mon propre premier baiser. Pour me rendre compte, avec dépit, qu’il m’avait aussi été volé. J’étais au lycée, avec mon groupe d’amis, et, pendant que je m’enflammais à propos de je-ne-sais-quel-sujet, mon premier amour de l’époque m’embrasse pour me faire taire. Trop choquée, je ne réagis pas, et je continue même ma diatribe. Qu’il s’empresse d’avaler d’un autre baiser. Mon meilleur ami, à côté, mort de rire. Et moi, un peu désabusée. En plus, ce baiser avait un goût de sauce tomate de la cantine. Mon premier baiser, je l’ai reçue pour me faire taire. Ce n’était pas romantique, ce n’était pas intense. C’était un “ta gueule, pleaze”. Avec un goût tomate. Quelle tristesse.
Aujourd’hui, j’espère que les jeunes filles qui ont l’âge que j’avais à l’époque se révoltent dans pareilles circonstances. A l’époque, c’était à dix mille lieues de mes revendications actuelles. J’ai appris de tout ça. Et avec mon mari, je peux me targuer d’avoir eu le premier baiser le plus romantique. Celui, justement, qu’on fantasme dans les films. Dans un hall d’aéroport, lui me rejoignant, moi trottant avec ma valise, ayant acheté un billet d’avion pour le rejoindre sur un coup de tête, et l’embrasser devant des dizaines d’inconnus, car tout, autour, me paraissait dérisoire et sans importance.
✨ Faut-il que des green romances ?
Nouveau label qui émerge pour s’opposer au sous-genre de la dark romance qui romantise des comportements toxiques voire violents : la green romance. Mais, comme l’avanceraient certain.e.s détracteurices, la green romance nous condamne-t-elle à des relations chiantes et ennuyantes ? Ou tout est beau, tout le monde est gentil, respectueux, sans défaut. Avec un consentement éclairé à chaque étape.
D’après moi, non. Pas du tout, au contraire. Rien n’empêche d’explorer les personnalités de chaque personnage, tout en nuance. Dénoncer les comportements problématiques ne signifie pas qu’on doive s’en passer. Je vous vois froncer des sourcils. On peut avoir des personnages qui font acte de gestes ou de paroles répréhensibles. Mais, tant que cela est déficelé, déconstruit, dénoncé, où est le souci ? Au contraire, je trouve cela extrêmement intéressant, comme axe d’évolution d’un personnage, qu’un partenaire qui se rend compte qu’iel est un.e mauvaise compagne.on, et qui va avancer là-dessus, se remettre en question. Pour prouver que cela est possible pour chacun.e d’évoluer sur la question.
Attention néanmoins au faux gentil. Notamment chez les hommes au syndrome du “nice guy”. Celui qui mériterait de l’attention, parce qu’il est gentil. Et que si la fille en face ne lui renvoie pas ses faveurs, c’est que c’est une sal*pe, parce que lui, il est gentil ! Sur le sujet, les premiers posts du compte de Ross.Geller.Hate.Account sont sans appel !
Pour moi, il n’y a aucun souci à conjuguer Green Romance et Dark Romance. Les deux méritent d’exister en harmonie (contrairement à la Nation du Feu) et personne n’est interdit de consommer soit de l’un, soit de l’autre (soit d’aucun). La nuance, cependant, serait de faire la part des choses, et de conscientiser que l’un de ces deux sous-genres (pour peu que l’autre soit suffisamment déconstruit sur les schémas présentés) décrit des relations qui sont, dans la vraie vie, inacceptable. Une sorte de fantasme que l’on vit par procuration, grâce à la fiction. Mais en prenant conscience que, dans la vraie vie, ces comportements sont qualifiables de crimes.

Le problème de la fiction, c’est qu’elle implante dans les inconscients collectifs des schémas modèles, qu’il nous faudra reproduire pour nous conformer aux soi-disant attentes. Que, jusqu’il y a peu, beaucoup de grandes œuvres ou du moins populaires, ont été réalisées par des hommes, pour des hommes. Ou de montrer aux femmes des modèles de vertu. Clamer que les choses ont changé depuis que les femmes sont majoritaires dans le domaine littéraire est faux, car beaucoup ont intériorisé des schémas misogynes (rivalités féminines, la fille “pas comme les autres”…) et des clichés issus du male gaze. C’est encore plus pernicieux, car sous couvert de “féminisme”, on nous vend parfois des relations malsaines comme étant sexy et romantiques, d’où le fait que je me méfie toujours quand une autrice vend son propre livre comme un roman féministe ; cet avis doit venir des lectrices elles-mêmes pour valider. Les histoires d’amour restent, encore de nos jours, très teintées par ce que le patriarcat a voulu marteler. Même des personnages féminins qui tentent de s’émanciper des carcans finissent par retomber sur les rails de relations amoureuses hétéronormées très convenues.
Un autre passage du livre de Chloé Thiebaud m’a marquée à ce propos :
Durant mon adolescence, ou même à l’âge adulte, je n’ai pas le souvenir d’un personnage d’homme gentil qui était vraiment désirable. Soit il était le bon copain, soit le meilleur ami gay, mais il ne tenait jamais la distance face au bad boy. Or, si la pop culture enseigne aux filles que les gentils ne sont pas désirables, les garçons finissent par intégrer qu’ils ne doivent pas être gentils pour leur plaire, et tout le monde est perdant. Personnellement, j’ai déjà conseillé à des amis masculins d’être moins gentils, au risque de ne pas “vendre du rêve”.
✨ Amour ou désir ?
La question pourrait être tournée de manière philosophique et je ne me risquerai pas là-dedans. Néanmoins, le lien est vite formé quand on parle d’amour dans un roman. En réalité, j’ai davantage l’impression qu’on traite de la désirabilité. D’un bookboyfriend, beau, sarcastique, protecteur, pour lequel on fond en attendant sa fameuse scène de smut. Le désir est-il propre à chaque personne ou nous l’enseigne-t-on par les schémas avec lesquels on nous gave, comme l’explique le paragraphe antérieur ?

Je pense que nous avons tous plus ou moins nos préférences, même si elles dénoncent aussi, d’une manière chez certains, des reliquats racistes, homophobes ou transphobes. J’ai déjà entendu mille fois, y compris de ma propre bouche “ah moi, ce qui me fait craquer, ce sont les grands, très grands, blonds, avec une voix de ténor”. Comme si ces critères de désirabilités, basés sur une construction sociale avec œillères, et donc sur… du vent ?, excluaient d’office tellement plus de personnalités, d’identités, avec lesquelles on aurait vécu tant de choses, partagé peut-être beaucoup plus que notre grand blond. L’être humain est parfois un mystère sur les phénomènes qui déclenchent le coup de foudre, sur ce qui transforme la simple considération en attirance (et qu’on ne me parle pas de phéromones, this is pure bullshit).
J’avoue que c’est un sujet que j’ai beaucoup aimé explorer sur certaines œuvres, et je vais justement y venir. Disons qu’avec le recul, je distingue deux schémas dans les dynamiques. Les relations qui commencent avec une rencontre, puis une amitié, et le lien de confiance se transforme progressivement en amour, avec un désir dont on questionne l’absence, et qui finit par apparaître, telle la naissance d’un phénix. Puis, de l’autre côté, la chronologie opposée, du crush physique et inexplicable… qui va finalement se concrétiser en une relation, même si on se rend compte que les personnages ne sont pas faits l’un pour l’autre. Des crush, dans ma vie, j’en ai eus. Beaucoup. J’ai été un putain de cœur d’artichaut. Mais généralement, il m’a suffi de quelques semaines/mois pour faire tomber les masques et me rendre compte que, derrière les belles apparences désirables, se trouvait une personne avec laquelle je partageais au final bien peu en commun (sauf Jensen Ackles. Lui, il est handsome). Et cette recherche de profondeur (sans mauvais jeu de mots), je trouve que peu de films/livres se l’accordent. Généralement, parce que le format est court, il faut aller à l’essentiel. Mais on nous apprend qu’un crush qui nous accorde son amour ne doit presque ne jamais être remis en question. Tout est beau, tout est merveilleux. Il manque cette connexion, cette complexité qui nous permet de comprendre réellement POURQUOI et COMMENT ces personnages en viennent à s’aimer et, pourquoi pas, à s’engager.

Dans les romances en littérature, reste donc à savoir ce que l’on recherche. Un fantasme ? Un objet de désir ? Ou le récit d’une relation amoureuse sous bien plus d’aspects que les simples apparences, gratinées d’un soupçon de sassy ? Et ça, je pense que c’est à chacun.e d’identifier. Sans en venir ensuite à reprocher, à un genre ou à l’autre, de ne pas correspondre aux attentes.
Et là-dessus, je pense qu’il est intéressant de se livrer à une analyse suivante, pour comprendre le cheminement de mes pensées et de mes réflexions.
🔮 Ludo Mentis Aciem
Pour rappel, LMA est une fanfiction Harry Potter que j’ai écrite entre 2012 et 2020. Elle suit la scolarité de nouveaux personnages, entre leurs 11 et 18 ans. De ce fait, le thème des premiers amours est largement exploré. Mon seul regret, à l’heure actuelle, est d’être restée cantonnée à des romances principales très hétéronormées, malgré la présence à côté de personnages secondes ou tertiaires LGBTQIA+. J’ai déjà présenté la plupart des personnages principaux masculins dans l’une de mes précédentes lettres, mais j’aimerais étayer un peu plus ma manière d’écrire les relations. De nouveau, les paragraphes qui suivent comportent des spoilers et je vous retrouve plus tard, si vous voulez les éviter.
🦉 Kate et Emeric
Kate est la protagoniste au centre de cette très longue saga de 1.5 millions de mots et le couple qu’elle forme avec Emeric devient central à partir du tome 5. Pourtant, imaginez-vous que je savais que cette romance se concrétiserait… dès le début. Les plus vigilants, ou les relecteurices, auront remarqué que le personnage d’Emeric apparaît dès le premier chapitre. Et que c’est d’ailleurs dès ce premier chapitre qu’il a un énorme coup de foudre pour Kate, même si on ne l’apprendra que bien plus tard.
Kate, c’est la fille solaire. Elle est appréciée, elle est sociable, elle prend particulièrement soin des autres. Très intelligente et scolaire, elle a tendance à se montrer vite anxieuse et est particulièrement maladroite, même si elle apprend avec le temps à apprivoiser son corps grâce au sport. Elle part vite en besogne, se fait trois millions de films en tête, et s’enflamme parfois trop vite (le caractère sanguin de son paternel). Elle n’est pas “la fille pas comme les autres”, au contraire. Physiquement, elle est assez typique, elle aime et assume sa féminité, elle aime se faire des amies, elle ne dénigre personne pour se mettre en valeur. Et de l’autre côté, on a Emeric, qui, au départ, est présenté comme le cliché de “l’intello”. Timide, en décalage, commençant toutes ses phrases par “techniquement” pour corriger ses interlocuteurices. Comme on ne suit pas son point de vue sur les premiers tomes, on a au début du mal à le cerner, et on se rend compte qu’il est bien plus. C’est un musicien hors pair, un grand rêveur.
Si on comprend après 2-3 tomes qu’Emeric a un énorme crush sur Kate (sans pour autant l’embarrasser. Il respecte toujours ses distances et se comporte avec elle comme un camarade supportive [pourquoi n’existe-t-il pas de mot en français]), Kate de son côté a un énorme crush sur le gars populaire de sa promotion : une pauvre tête de con nommée Griffin. Avec lequel elle va d’ailleurs sortir un temps. Ce qui éveille une terrible rivalité entre Emeric et Griffin, évidemment. L’intello réservé VS le mec sportif populaire. Et pourtant, Emeric va lui-même finir par se mettre en retrait. Par respect pour Kate. Il ne lui reprochera jamais rien, ne se moquera jamais de sa relation avec Griffin. Il avancera de son côté et lui vouera toujours cette même fidélité (même s’il se découvre d’autres aspects pendant son échange à Durmstrang pendant sa cinquième année, ce que j’ai développé dans un spin-off intitulé Sum Presentaliter Absens in Remota).
Kate et Emeric se découvrent, au final, beaucoup de points communs et, leur éloignement avec l’année d’échange d’Emeric, va paradoxalement créer un rapprochement entre eux. Mais surtout, un élément sur lequel ils se retrouvent : tous deux ont une part obscure. Genre. Très obscure. Les deux vont avoir, pendant l’histoire, des comportements répréhensibles. Mais à chaque fois, cela est remis en question, que ce soit au sein de leur couple ou vis-à-vis des personnes qui les entourent. C’est un couple qui se porte, qui apprend à appréhender le monstre qui sommeille en l’autre, pas pour l’apprivoiser, mais pour protéger la part lumineuse de la personne qu’iels aiment.
On est ici sur un double-trope des âmes-soeurs et de l’amour maudit, avec tout son lot de drama qui va avec. Mais au-delà des aspects narratifs liés à l’intrigue, ça a été très intéressant de développer la relation entre les deux, notamment du point de vue de Kate, qui évolue au fur et à mesure des tomes. De reconnaissance, vers l’amitié, jusqu’à l’amour (avec un passage par le désir pas toujours évident, puisque Kate menace d’exploser ses jeunes amants avec sa magie étrange).
🐻 Terry et Maggie
La relation romantique entre les deux meilleurs amis de Kate se construit au fur et à mesure de la saga, même si l’amitié se forme dès le début, avec une complicité très forte. Rien ne déterminait forcément ces deux-là à se fréquenter. Maggie est une Gryffondor héritière d’une très riche famille bourgeoise, orgueilleuse, hautaine et très portée sur les apparences ; Terry est un Poufsouffle, enfant unique d’un couple de travailleurs londoniens, social, fondamentalement bienveillant et présentant un physique imposant. C’est leur amitié pour Kate qui va les rapprocher et leur faire comprendre que les opposés s’attirent.
La relation commence à se construire dans la partie III, quand Maggie se rend compte des sentiments qu’elle développe envers son ami, qui est l’un des seuls à voir au-delà de l’image superficielle qu’elle renvoie, toujours dans le contrôle. Elle va même développer une importante jalousie envers la petite amie de Terry de l’époque. Mais comme Maggie est une handicapée sociale, il va lui falloir beaucoup de temps avant de lui admettre ce qu’elle ressent. Même si cela va à l’encontre des pressions familiales… Car même si la relation amoureuse entre les deux se concrétise petit à petit, on découvre dans le tome VI que Maggie est en réalité fiancée depuis son plus jeune âge, histoire de rajouter un peu de drame.
Le couple de Terry et Maggie, c’est l’histoire d’un couple, jeune, qui apprend à se construire sur des bases étonnamment solides dès le départ, avec beaucoup de maturité (merci Terry pour le coup !). Même s’iels sont très différents l’un de l’autre, et issus de mondes opposés, ils ont toujours mis au centre le respect et l’écoute sans jugement (ce qui n’a pas été évident pour Maggie au début). De là à dire que ce couple est parfait, avec le schéma du “gentil nounours x la fille de bourges’”, serait assez mensonger. Déjà, parce que le couple passe par de nombreuses péripéties (et Terry n’est pas exempt de défauts, avec ses rares crises de colère. Comportements qui sont aussitôt dénoncés). Et parce qu’on reste dans une dynamique adolescente, avec un focus sur quelques années. Celleux qui ont lu le “ce qu’ils deviennent” (eh oui, toujours !) auront relevé que, malgré quelques années heureuses et les débuts d’une vie de famille, Maggie et Terry divorcent. Les raisons, je pourrai les expliquer, mais j’aime garder le secret ce qu’il s’est produit…
🐺 Et beaucoup d’autres.
Il y aurait tellement de relations romantiques qu’on pourrait souligner. Entre Phil et Grace, les parents de la protagonistes. Entre Wolffhart et son véritable amour, Elise. Les sentiments forts et destructeurs de Morgana pour Kate, de Merrick pour Phil…
Mais en fait, la morale de LMA ne se situe pas dans ses relations romantiques, même si elles occupent une place non négligeables. Je me souviens très bien, quand j’ai publié la fin de la partie VII et que j’ai laissé mariner les lecteurices pendant des mois (car j’avais vendu la partie VII comme étant la fin… sauf qu’elle finit sur un gros cliffhanger. J’ai gardé le secret/”mensonge” pendant 8 ans ! Je vous laisse imaginer ma jouissance !), j’avais essayé de glisser des indices. Et j’avais dit :
La fin se déroule là où tout commence. Dans la relation, dans l’amour qui est au centre de toute la saga.
Et beaucoup ont oublié un point essentiel. LMA, oui, c’est une histoire d’amour avec une thématique très spécifique. LMA, ça raconte l’amour père-fille. C’est le cœur même de toute l’histoire. L’une des relations qui prend le plus de place, et dès le début, c’est celle entre Kate et son père Phil. Une relation entachée par l’adolescence de Kate, par les non-dits, par les secrets gardés pour protéger l’un et l’autre. C’est l’histoire d’un père prêt à aller à Azkaban pour sa fille, d’une fille qui veut suivre les traces de son père coûte que coûte. C’est le parallèle avec l’attachement presque paternel entre Kate et son professeur Wolffhart, ce dernier ayant perdu sa fille unique. LMA commence, dès le premier chapitre, sur cette complicité père-fille, et c’est ainsi qu’elle finit. Un duel presque à mort, un sacrifice que l’on pense obligatoire… Un amour extrême et pur, dévoué.
✨ Et les autres formes d’amour dans tout ça ?
Et en fait, c’est ça qui me “gonfle” dans les romances. Le fait qu’on élimine d’office toutes les autres relations, car elles seraient moins “importantes” que l’amour romantique et sexuel. On met de côté l’amour fraternel. L’amour sorore. L’amour filial, ou même anté-filial. L’amour platonique. Les amours amicales (oui oui, au pluriel, amour devient féminin). Comme si la romance devait tout éclipser, reléguer ces dynamiques en arrière-plan. Sauf que c’est FAUX. L’être humain est un être social (malheureusement pour moi) et de ce fait, il se construit à travers ses relations en conjuguant les différentes natures de ce dernier.
Vous me verrez assez rarement vous narrer des personnages qui n’ont pas de famille. Vous savez, ces personnages qui vivent leur vie, seuls, comme nés de la pluie, indépendants, autonomes, sans passé. Je ne peux, personnellement, pas me dissocier de mon identité familiale et amicale. Aussi, j’ai toujours eu à coeur de mettre ces relations au coeur de mes récits, car elles ne sont pas moins importantes, au contraire. Elles sont le ciment d’une identité, d’un parcours de vie. Cela ne signifie pas que tout est rose. J’ai conté des familles aimantes et des familles dysfonctionnelles as well. Peut-être que cela méritera sa lettre à part, la famille, parce qu’il y a tant à en dire !
Mais c’est en écrivant LMA et en me rendant compte du tour de force que j’avais accompli avec la relation Kate-Phil que je me suis rendu compte qu’il devenait urgent que je détricote la pelote toute belle qu’on nous vend à propos de l’amour, et me rendre compte qu’elle était pleine de nœuds. Et là-dessus, il y a une oeuvre qui m’a ouvert la porte à toutes ces expérimentations du coeur : Persona.
Même si vous ne voulez pas lire les analyses, je vous invite vraiment à vous pencher sur celle de Persona pour aborder le sujet de l’aromantisme et de l’asexualité.
🏛️ Persona
Quand je dois décrire Persona, j’explique qu’il s’agit d’une ode à la différence et à l’amour sous toutes ces formes. Quand on me demande s’il y a de la romance, je réponds “non”. Pourtant, aucune de mes œuvres ne comporte autant d’amour dans sa forme la plus pure que Persona. Paradoxal ? Pas vraiment. Est-ce le fait que les consommateurices n’y sont pas encore habitué.e.s ? Je ne sais pas. Mais je connais mon but en écrivant cette œuvre : offrir un cocon, une étreinte aux lecteurices, les faire se sentir aimé.e.s. Une histoire qui met du baume au cœur et qui les accepte tel.le.s qu’iels sont. Ambitieux, n’est-ce pas ?
Je ne pourrai vous raconter en détails la construction de toutes ces relations, car cela pourrait vraiment spoiler les tomes 3 et 4, qui ne sont pas encore parus.
🎭 Andrea
On pourrait consacrer une lettre entière à Andrea. Je n’avais, au départ, pas l’idée d’en faire cellui qu’iel est, mais… iel s’est présenté.e à moi tel.le quel.le. C’est devenu très naturel de présenter là un personnage qui, au-delà de sa genderfluidité, a sa propre manière de conjuguer l’amour. On comprend assez rapidement dans le tome 1 qu’Andrea est aussi ace/aro. C’est-à-dire asexuel.le (n’a pas d’attirance pour les relations sexuelles de quelques sortes que ce soit) et aromantique (n’éprouve pas de sentiments amoureux). Ce qui pose évidemment problème par rapport à son dilemme personnel, dans une société où se marier permet d’être libre quand on était touché.e par la Lumière. Et pourtant. Je crois, qu’au monde, il n’existe pas UN SEUL personnage qui ait autant d’amour en ellui qu’Andrea.
Cette distinction est mise en lumière (sans mauvais jeu de mots) dans un magnifique dialogue avec frère Bartholomée (le goat).
— Toute ma vie, j’ai cru que je n’étais pas capable d’aimer comme les autres s’aiment, juste parce que j’étais Persona. Mais en fait, non… Eden vous aimait. Et il aimait Nuna. Et…
Bartholomée comprenait le sens de ses rictus indéchiffrables pour le commun des mortels : c’était une expression de joie. De libération soudaine.
— Longtemps, je pensais que c’était une malédiction de Persona. De ne pas savoir qui j’étais. De ne pas éprouver l’amour tel qu’on le raconte dans toutes les belles histoires.
— Il y a une différence entre l’amour et le désir, mon cher ami. Ne pense pas que tu es incapable d’aimer, bien au contraire. Tu as trop d’amour pour toute l’humanité entière. Mais le fait que tu ne ressentes pas le besoin de construire une relation romantique ou charnelle avec quelqu’un, ce n’est pas une malédiction de Persona, comme tu dis. C’est ta particularité à toi. Ça te caractérise toi, Andrea.
Andrea n’est qu’amour et pardon. Ce qui a créé parfois des scènes très confuses (ex : on m’avait demandé de réécrire le passage où Eloïse décide de mettre à mort Andrea. Mon éditrice s’attendait peut-être à une confrontation plus dramatique. En réalité, Andrea s’est excusé.e, a eu pitié d’Eloïse et l’a réconfortée. I mean. Je ne contrôle pas mes personnages. Iel écrive l’histoire. On a gardé ce nouveau passage tel quel). Ou des difficultés pour ellui à vivre avec d’autres émotions, notamment la colère, dans le tome 2.
🌿 Avec Pax
Comme la relation avec Kate et Phil est au centre de LMA, celle qui englobe la saga Persona est le duo Andrea-Pax. Andrea est un.e Persona de 17 ans ; Pax une gamine f(o)ugueuse de 10 ans. Et il se construit entre eux une magnifique relation d’adelphité, presque naturelle, un lien de confiance inébranlable. On comprend mieux leur relation en explorant leurs passés respectifs. Andrea a perdu une soeur mort-née ; Pax a été abandonnée par ses parents à la naissance, ne sait pas d’où elle vient et si elle a une famille. Tous deux sont en recherche de ces figures qu’iels ont perdu. Et toute l’histoire repose sur une seule promesse : celle de lancer ensemble une lanterne pour le Lucernarium, la fête de la Lumière. C’est beau, quand même.
Pax est une jeune femme en construction. De la petite fille sauvage, on la voit évoluer grâce à Andrea pour devenir une adolescente de plus en plus sage. Elle apprend la confiance et à se découvrir elle-même, pendant qu’Andrea, ellui, s’est mis en tête de protéger l’enfance et l’innocence de Pax à tout prix, comme l’enfance dont iel a été privé.e. Iels se respectent mutuellement, s’excusent l’un envers l’autre, nourrissent une grande complicité, s’acceptent tel qu’iels sont, parfois dans leurs pires moments, dans les scènes les plus éprouvantes.
Et comme pour LMA, tout finit là où ça commence : c’est la relation entre Andrea et Pax qui va déterminer du dénouement de la saga. (pas de pression !)
🥧 Et toutes les autres
Il y en aurait TANT d’autres dont je pourrai vous parler.
L’amour grande sœur / petit frère entre Desideria et Isidore,
L’amour père spirituel / fille entre Melchior et Eloïse,
L’amour sororal entre Agnès et Ariane,
L’amour pluriel entre Bartholomée, Nuna et Eden (parce que oui, on a un trouple ! De personnes âgées, en plus, ce sont mes GOATs, ok ?)
L’amour “bromantique” entre Andrea et Evander,
L’amour père / fils entre Thomas et Evander,
Et toutes les relations romantiques, aussi, qui se tissent dans l’intrigue, mais DONT je ne PEUX PAS parler du fait de spoilers majeurs (on se retrouve pour une partie 2 de newsletter dans 2 ans ?)
Mais l’amour reste très présent, dans Persona. Je pourrai d’ailleurs pas passer à côté de ce dialogue entre Andrea et Isidore :
— On peut en vouloir à quelqu’un que l’on aime. C’est tout à fait permis. L’amour n’est pas une excuse universelle. Il y a trop de gens qui font des choses mal au nom de l’amour. Desideria ne fait pas exception. Elle t’a gardé dans ta Villa pendant des années, sans te permettre de rencontrer qui que ce soit à part les Eluminati… Elle a fait ce qu’elle pensait le meilleur pour toi, parce qu’elle t’aime, mais au final, elle t’a fait souffrir. Tu as fait ton choix pour te sortir de ça, pour prendre ta propre voie. Cela ne remet pas en cause votre amour pour autant.
— De la part de Desideria, ce n’est pas un « je t’aime » dont j’aurais besoin, je crois. Mais un « je te pardonne ».
— De quoi voudrais-tu te faire pardonner, Isidore ? Tu n’es pas le fautif dans cette histoire.
— J’aurais préféré qu’il en soit autrement.
[…]
— C’est pour nous, corrigea-t-il dans un murmure, sans brusquerie.
— « Nous » ?
— Ma mère m’a expliqué, quand j’étais plus jeune, que les relations étaient comme des plantes. Chaque lien crée une plante imaginaire. On en prend soin à deux. On la cultive avec amour, par défaut ou par envie. Certains auront beau l’arroser sans cesse, elle ne grandira jamais. D’autres plantes n’ont pas besoin d’être choyées pour survivre, elles résistent au temps qui passe. Il y a des plantes très fragiles, qui meurent au moindre oubli. Et des dernières qui subissent : l’une des deux personnes l’écrase et l’autre tente de la soigner comme elle peut pour la faire subsister, car elle est importante pour elle, et la première personne le sait, en profite.
L’image désarçonna Isidore. Elle lui plaisait cependant. Lui qui se n’exprimait qu’avec des concepts d’oiseaux, il trouvait là des explications intéressantes.
— La plante que j’ai fait grandir avec Pax est très importante pour moi, conclut Andrea. C’est l’une des plus belles de mon jardin.
— Je comprends…
Après un temps de silence, Isidore rebondit :
— Mon jardin n’est peut-être pas très grand, mais j’ai aussi des petites fleurs très jolies qui y poussent. J’aime beaucoup la tienne.
Andrea sourit, touché.
— Merci…
— Et j’ai surtout envie de l’aider.
Il leva alors le visage vers celui d’Andrea ; dans l’obscurité, le Persona sut que, cette fois, il le regardait droit dans les yeux, malgré l’effort que cela lui demandait.
— Je serai là pour sauver ta plante avec Pax.
Bref. Je veux écrire des plantes. Pas de belles roses écarlates comme dans la Belle et la Bêtes. Mais des mauvaises herbes. Des lierres rampants. Des fleurs sauvages. Des pissenlits éclatants, des chardons piégueurs et des marguerites en buisson. Des plantes qui peuplent notre monde et à côté desquelles on passe sans se soucier.
✨ Suis-je condamnée à n’écrire que sur l’amour ?
C’est la douce conclusion que je me dis. Mais pas l’amour comme on l’entend communément. J’écris des relations fortes, des liens où les mots manquent parfois, et où je dois user de techniques stylistiques pour leur rendre honneur. De ce fait, pourquoi cela devient-il difficile pour moi d’écrire de la romance dans sa définition la plus simple ? Parce qu’il y a tellement de facteurs autour, selon moi, et que de déterminer une identité qu’au travers d’un seul amour basé sur l’attirance est très unidimensionnel.
Actuellement, je suis en train d’écrire une “romantasy” avec des sorcières (sous contrat ! On se retrouve en 2026). Dans le sens où la relation amoureuse est au centre de l’intrigue. MAIS elle est très intéressante à écrire, car elle dénonce énormément de choses de par son schéma, initialement, très hétéronormé et justement implantée dans les moules originaux… pour mieux les déglinguer ! J’écrirai, je pense, dans ma vie, énormément de relations différentes, et je veux continuer à les diversifier, à offrir tout un tas de représentations plutôt que de rester sur des couples hommes/femmes très entendus. Dans le sens où, même si je traite d’un couple homme/femme, à l’image du mien dans ma vie perso, d’ailleurs, je ne manquerai pas d’ajouter des mentions par rapport à mes positions engagées. Et attention, cela ne signifie pas non plus que je ne proposerai que des green flag, c’est bien plus nuancé que ça (la romance du projet sorcière est TOUT sauf green flag ! Mais cette relation est OUF. Elle me demande énormément de boulot, parce que tout repose dessus, mais aaaaaah. C’est relou de rien pouvoir vous dire. RDV EN 2026 ON A DIT BABY !)

J’ai conscience que je me tire une balle dans le pied, dans un monde du livre de plus en plus marketé et où des livres avec des vampires/faes de 1000 ans les aînées de vierges adolescentes (ou le professeur avec son élève. Ou le demi-frère avec sa demi-soeur 🤢) seront bien plus plébiscités que des histoires mettant à l’honneur des amours familiales ou amicales (même si avec leur même dose de drame et de déconvenues) sans forcément passer par la case 🍑. Mais je suis en accord avec mes valeurs et je SAIS que j’aurai le public pour. Des gens qui, comme moi, ont besoin de continuer d’explorer la beauté de la complexité émotionnelle humaine au-delà du fantasme primaire. Est-ce hautain de raisonner ainsi ? Je ne sais pas. Je n’imposerai pas ma vision de l’amour dans les romans tout comme je ne souhaite pas qu’on m’impose le modèle romantique patriarcal comme le vrai et l’unique et le merveilleux et le brillant et le divin.
Un petit mot, d’ailleurs, sur le MxM, c’est-à-dire la romance entre hommes. J’en ai lues, plus jeune (les Drarry ne datent pas d’hier !). Mais elles ne sont pas exemptes de défauts. Surtout quand elles reproduisent des schémas patriarcaux et qu’elles deviennent l’objet de fantasme pour des femmes qui s’imaginent comment seraient construites des relations homosexuelles entre hommes. La preuve en est que les hommes gays ou bi… ne sont finalement pas les cibles de ces romans. Notamment quand les relations dépeintes dans ces livres reposent sur des traumas ou leur identité sexuelle.
En fait, je crois que c’est tout ça qui me saoule dans les romances. Le côté UNIDIMENSIONNEL. Sans nuance. Sans évolution. Sans construction de personnage. Où tout se décrit simplement, à plat, sur une fiche personnage, avec cinq adjectifs qui se retrouvent aussi démunis que 5 grains de riz planqués au fond du paquet. Les enjeux personnels passent à la trappe, les inconscients, le poids du passé, les valeurs propres à chacun.e. La famille, les ami.e.s, les collègues, la société dans son ensemble, avec ses contraintes et ses avantages. Le couple, le trouple ou polycule, fait partie d’un tout.

✨ Bon. Et t’as toujours pas parlé de smut.
L’autre chose, c’est l’omniprésence actuelle du smut, qui devient presque un passage obligatoire désormais. A comprendre des scènes (voire chapitres entiers) de relations sexuelles explicites. Je ne suis pas contre. J’en ai écrit, j’en ré-écrirai sûrement. Mais je ne le considère pas comme un passage à devoir absolument décrire. Les ellipses n’ont jamais tué personne et on rentre parfois dans une dynamique de voyeurisme quand on estime que SI, il faut en mettre ! Comme la différence dans les films, entre une scène romantique filée, métaphorique, avec des jeux d’ombre ou d’images et… un film porno, tout simplement. Oui, certaines scènes peuvent permettre de comprendre l’évolution d’une relation entre personnages (et de rendre les choses un peu plus torrides !). Mais on a tendance aussi, je trouve, à idéaliser ces moments dans les médias de divertissement. Qui n’a pas eu une première fois foireuse ? Le coup de la panne ? Ou d’un départ trop précoce ? Un coup de boule dans le nez ? Une crampe sur une position un peu trop ambitieuse ? Un fou rire au pire moment ?
Ce qui amène à des déceptions IRL si on se rend compte que non, le smut des romances ne sera pas forcément celui qu’on expérimente. Condamnés à la déception éternelle si on ne choisit pas de remettre en question ces modèles (même si un petit plaisir coupable ne fait pas de mal), et de profiter autrement de ces moments, en construisant des moments de complicité, de sensualité et d’érotisme sur une palette différente. Moins marketable, mais peut-être plus éthique ? En acceptant la diversité humaine ? Tout repose, selon moi, sur les messages que l’on renvoie par cet effet de répétition validé.
A-t-on besoin de faire de ses personnages de dieux du sexe qui pètent des têtes de lit et des armoires pour ne pas les décrédibiliser en tant qu’objet de fantasme ? Le personnage perd-il tout intérêt à partir du moment où on apprend qu’il a, par jeu de loterie génétique, un Justin Bridou apéro au lieu d’une saucisse d’un salami XXL ? L’amour se prouve-t-il seulement par le smut ? Une relation sans smut a-t-elle donc moins d’intérêt ? Cela signifie-t-il que les amours asexuelles ne valent rien ? C’est extrêmement réducteur.
On peut assumer écrire/lire des romans pornographiques, je ne vois pas le souci. Mais tout comme on rappelle que le porno à l’écran n’est pas la “vraie vie” et ne devrait pas influencer la conception de l’amour dans l’intime en défiant les limites et le respect d’autrui, on rappellera que le porno sur page n’est pas la “vraie vie” non plus. Il restera à recontextualiser. Et si vous rejetez les livres ne contenant pas de smut, ne remettez pas en cause les romans en question, mais votre propre conception de l’amour, qui mérite une petite psycho-analyse personnelle. Les livres sans romance, sans smut, ne sont pas mauvais. Ils racontent autre chose. Parfois, ça reste de l’amour. Mais une vision de l’amour qu’on ne vous a peut-être jamais présentée avant, puisque nous sommes conditionné.e.s depuis le plus jeune âge aux schémas hétéronormés rencontre/bisou/baise/mariage/bébé.
Devenez curieux.ses. Lisez, parfois, ce qui sort de votre zone de confort. Je vous promets que vous risquez d’en sortir… changés.
✨ Quelques astuces pour décrire l’amour romantique
Avec l’expérience et l’analyse que je tire de mes propres consommations de contenu de divertissement, voici quelques éléments qui, peut-être, vous permettront d’écrire des romances qui ne laisseront pas insensibles, tout en déconstruisant tranquillement les schémas trop convenus et hétéronormés :
Sortir des carcans du genre. Une femme musclée ou se livrant à des activités dites “masculines” peut être très sexy. Un homme sensible, qui s’occupe des autres (des tout-petits, des personnes âgées), peut être très sexy.
Les jeux de regards et de sourires. Alors, par contre, je ne suis pas fan des sourires carnassiers, on vire très vite à la psychopathologie. Mais le petit sourire en coin en apercevant l’élu.e de son coeur, qui s’efface vite pour dissimuler. Le regard attendri dans le dos de la personne quand celle-ci ne regarde pas, mais qu’un autre personnage capte.
Décrire un élément corporel attirant, sans forcément pointer des zones sexualisées (type la poitrine, les fesses, etc.). Ca peut être un geste, une main dans les cheveux, la respiration au creux des clavicules pantelantes, les pommettes qui se rehaussent quand on sourit, l’angle d’une mâchoire, des tâches de rousseur. Personnellement, mon kink, ce sont les mains et les avant-bras, car les mains et doigts en disent beaucoup sur l’identité de quelqu’un. Je sais que pour d’autres, ça peut être les mollets !
Les petites attentions désintéressées. Souvent d’un rien. Un personnage a mentionné son attirance/son dégoût pour quelque chose, et l’autre fait en sorte de lui apporter/l’en priver plus tard, sans faire reconnaître son effort pour obtenir une médaille/une récompense/un cookie/un bisou. C’est montrer la prise en compte de la parole et la validation des sentiments. Et c’est beau.
Les dilemmes moraux, notamment quand il y a conflit d’intérêt. De voir si le personnage va mettre au centre sa relation plutôt que ses autres valeurs. Parfois sa propre famille.
Les effleurements. Ca, c’est mon côté collégienne fleur bleu qui est resté collé à la peau. Mais quand des mains se frôlent. Quand une odeur volatile est captée brièvement. Quand on n’ose pas toucher de peur de briser. Le petit frisson. VRAIMENT, ça c’est ma vie, et c’est tellement puissant pour les slow burn.
Ne pas opposer désir ardent et consentement. Les deux ne sont pas incompatibles, je vous assure ! A vous de trouver comment. N’hésitez pas à aller sur le compte d’Orgasme et Moi pour trouver de beaux témoignages qui peut-être vous inspireront.
✨ Ma recommandation pour aller plus loin
Complètement lié au sujet, je peux vous renvoyer vers l’essai de Mona Chollet : Réinventer l’Amour. Je ne suis pas une adepte de Mona Chollet ; je n’ai pas aimé Sorcières, du fait de mes désaccords profonds avec certains propos tenus, notamment autour de la maternité, et Beauté Fatale, s’il aborde des points intéressants, m’a laissée mitigée. En revanche, ce titre-là est celui sur lequel je me retrouve le plus et qui a été très instructif pour poursuivre le cheminement de déconstruction, dans l’idée de devenir une personne plus épanouie, vis-à-vis d’elle-même et de mon couple (car ça fait du bien quand on complexe de ne pas remplir toutes les cases des amours hétéronormatives classiques dont les injonctions sont aliénantes).
Voici le résumé :
Nombre de femmes et d'hommes qui cherchent l'épanouissement amoureux ensemble se retrouvent très démunis face au troisième protagoniste qui s'invite dans leur salon ou dans leur lit : le patriarcat. Sur une question qui hante les féministes depuis des décennies et qui revient aujourd'hui au premier plan de leurs préoccupations, celle de l'amour hétérosexuel, ce livre propose une série d'éclairages.
Au cœur de nos comédies romantiques, de nos représentations du couple idéal, est souvent encodée une forme d'infériorité féminine, suggérant que les femmes devraient choisir entre la pleine expression d'elles-mêmes et le bonheur amoureux. Le conditionnement social, qui persuade les hommes que tout leur est dû, tout en valorisant chez les femmes l'abnégation et le dévouement, et en minant leur confiance en elles, produit des déséquilibres de pouvoir qui peuvent culminer en violences physiques et psychologiques. Même l'attitude que chacun est poussé à adopter à l'égard de l'amour, les femmes apprenant à le (sur ?) valoriser et les hommes à lui refuser une place centrale dans leur vie, prépare des relations qui ne peuvent qu'être malheureuses. Sur le plan sexuel, enfin, les fantasmes masculins continuent de saturer l'espace du désir : comment les femmes peuvent-elles retrouver un regard et une voix ?
Je vous souhaite à tous un excellent week-end et vous retrouve en mars pour… de graaaaandes choses ! 👀






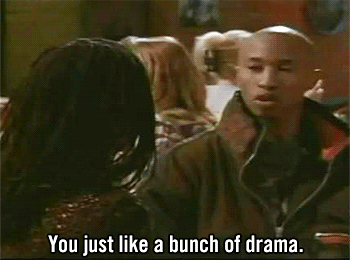
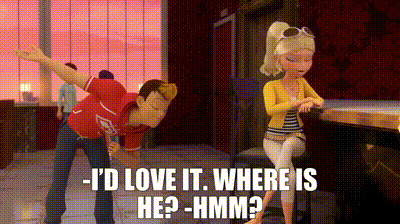


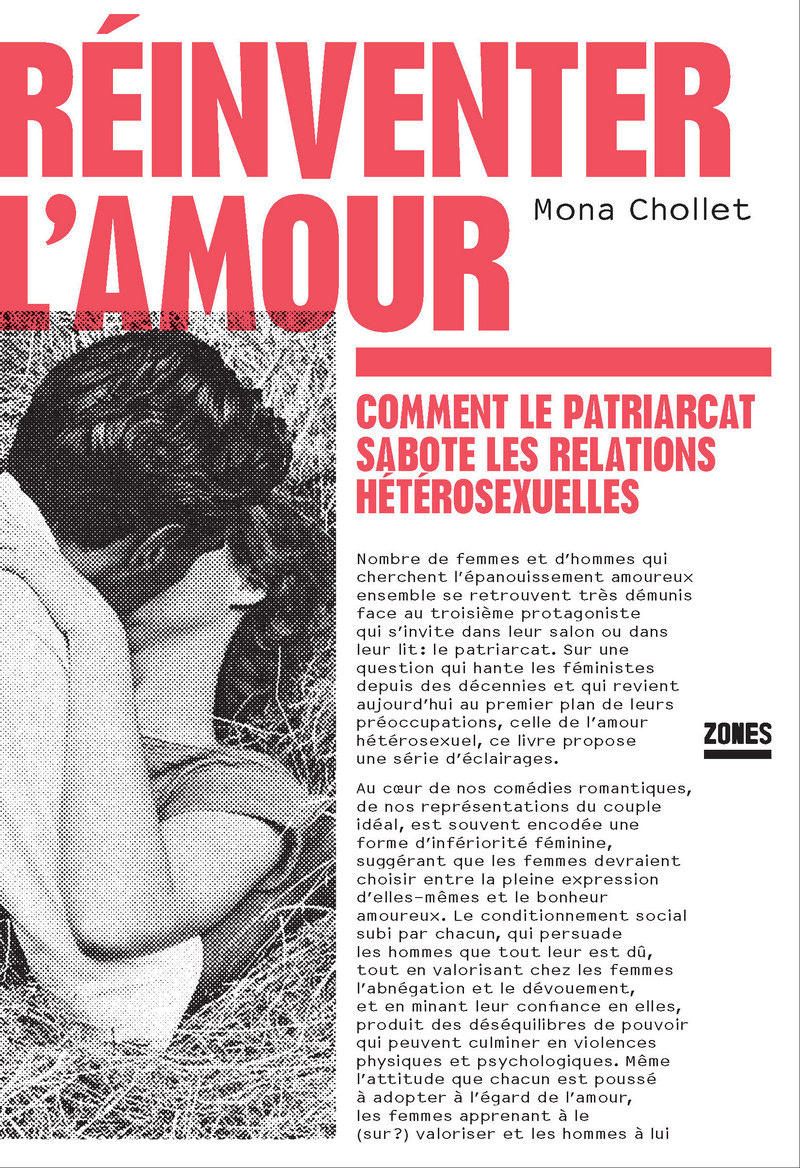
Encore une masterclass. J'ai adoré du début à la fin et je me suis beaucoup reconnue. Ca m'a aussi fait réfléchir à mon propre rapport à la romance et à mes propres personnages. Merci !
J'ai adoré cette lettre, elle m'a beaucoup parlé !
C'est drôle, car c'est aussi beaucoup de questions que je me suis posée et qui ont guidé ma manière d'écrire ces dernières années, mais aussi mon rapport à la lecture des romances.
Perso, je déteste les romances où le smut prend le dessus et on a plus d'intrigue, plus aucune évolution. J'en viens même à lire beaucoup plus de YA dernièrement (car j'adore ça), mais aussi parce que je trouve qu'on est plus sur l'émotion, sur le ressentis et c'est ce que je préfère !
En livres qui dénoncent et mettent en avant des romances, avec des fins où les héroïnes remettent les choses en questions, y'a les romans de Holly Bourne. Elle écrit principalement du YA, dénonce des schémas, en joue, et le couple est un outil, mais pas une finalité. J'ai lu "It only happens in the movies" et "Am I normal yet" et j'ai adoré !
Sinon, y'a un truc que je peux plus me voir en romance, c'est le sacrifice de l'héroïne au nom de l'amour. Ce moment où elle renie tous ses rêves, toutes ses ambitions, tout le boulot qu'elle a fourni pendant des années, pour un mec. Souvent, je trouve que c'est mal amené, mal fait, mal expliqué. Car bien sûr, on peut renoncer à une carrière par amour (chacun fait sa vie), mais je trouve qu'on parle jamais des répercussions (car faut faire rêver) et je trouve insupportable cette injonction selon laquelle les femmes sont des êtres faits pour aimer, et donc ne peuvent pas privilégier un autre aspect de leur vie, et si elles renoncent pas, on les fait grave culpabiliser...
En tout cas, j'ai eu grand plaisir à lire ta lettre (et les autres aussi) !
Bonne journée